La sanction de nullité de la clause d’intérêt est abandonnée au profit de celle de déchéance du droit aux intérêts sans qu’il y ait lieu de distinguer si le grief siège dans l’offre de prêt ou dans le contrat constatant un acte de prêt.
Le revirement est caractérisé par deux décisions :
![]() Civ 1ère 11 mars 2020 n°19-10875 Publié : L’année lombarde n’est sanctionnée que par la déchéance des intérêts lorsqu’elle a une incidence sur le taux stipulé de plus d’un dixième de point ;
Civ 1ère 11 mars 2020 n°19-10875 Publié : L’année lombarde n’est sanctionnée que par la déchéance des intérêts lorsqu’elle a une incidence sur le taux stipulé de plus d’un dixième de point ;
![]() Civ 1ère 10 juin 2020 n°18-24287 Publié : Le TEG absent ou erroné dans un écrit constatant un acte de prêt n’est sanctionné que par la déchéance des intérêts selon l’appréciation souveraine des juges du fond.
Civ 1ère 10 juin 2020 n°18-24287 Publié : Le TEG absent ou erroné dans un écrit constatant un acte de prêt n’est sanctionné que par la déchéance des intérêts selon l’appréciation souveraine des juges du fond.
En préférant la déchéance des intérêts à la nullité de la clause d’intérêt, la 1ère Chambre décide que l’année lombarde et le TEG ne sont plus des critères de validité de cette dernière.
Cette nouvelle solution de déchéance (III), prévue pour le TEG (II), s’accorde mal avec la notion même de taux d’intérêt (I) [1] .
I. Le taux d’intérêt.
1. La nature juridique de l’intérêt est celle d’un loyer.
Une forte tradition historique dénonce l’immoralité de l’intérêt. La formule « Nummus non parit nummos » [2] attribuée à Thomas d’Aquin résume son point de vue : « La monnaie a été principalement inventée pour les échanges ; ainsi son usage propre et premier est d’être consommée, dépensée dans les échanges. Par suite, il est injuste de recevoir un prix pour l’usage de l’argent prêté ; c’est en cela que consiste l’usure. »
Cette considération se conforte sur l’antique conception du prêt comme un geste (fraternel et gratuit) opérant transfert temporaire du droit de propriété dans le contexte d’une économie de subsistance.
C’est donc la nature du contrat de prêt qui détermine la nature de sa contrepartie entre solidarité ou mercantilisme.
Depuis que le prêt n’est plus un transfert temporaire du droit de propriété, mais se réduit au seul transfert temporaire de l’usus, du droit d’user de la chose prêtée, l’intérêt a la nature d’un loyer puisque le prêt répond alors parfaitement à la définition du contrat de louage comme étant celui « par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer » [3].
L’intérêt n’est autre que le prix du loyer à payer en contrepartie de la jouissance du capital prêté.
2. L’intérêt est conventionnellement mathématique.
Le recours à un taux pour la détermination de l’intérêt fait de facto entrer les mathématiques dans le champ juridique au titre du principe de détermination du prix, énoncé à l’occasion du contrat de vente par l’article 1591 du Code civil lequel stipule pour mémoire que « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. »
Il en va naturellement de même du prix du louage qui ne peut être indéterminé ou indéterminable faute de quoi, en l’espèce, le prix sera l’intérêt légal par application de l’article 1907 du Code civil.
Le taux d’intérêt est sauf mention contraire toujours annuel. Il constitue l’élément principal de la convention de détermination du prix du loyer du prêt, et cette convention est une formule mathématique assez simple :
intérêt = capital x taux annuel x nombre de jours d’intérêt / nombre de jours de l’année
La finance a dégagé plusieurs conventions temporelles pour le calcul d’intérêt qui déterminent le nombre de jours d’intérêt entre deux dates et le nombre de jour de l’année. Les conventions courantes sont :
![]() Exact/exact = nombre de jours exacts de la période / nombre de jours exacts de l’année ;
Exact/exact = nombre de jours exacts de la période / nombre de jours exacts de l’année ;
![]() Exact/365 = nombre de jours exacts de la période / 365 jours ;
Exact/365 = nombre de jours exacts de la période / 365 jours ;
![]() Exact/360 = nombre de jours exacts de la période / 360 jours ;
Exact/360 = nombre de jours exacts de la période / 360 jours ;
![]() 30/360 = les 28 ou 29 février sont des « 30 février », les 31 mars des 30 mars / 360 jours.
30/360 = les 28 ou 29 février sont des « 30 février », les 31 mars des 30 mars / 360 jours.
La base 30/360 est souvent confondue avec la base Exact/360. Soit une période courant du 20 janvier au 13 mars (non bissextile) : Exact/360 30/360
du 20 au 31 janvier 11 jours 10 jours
du 1er au 28 février 28 jours 30 jours
du 1er au 13 mars 13 jours 13 jours
nombre de jours d’intérêt 52 jours 53 jours
Soit un prêt de 10 000 € au taux de 3,84 %. L’intérêt dû pour la période du 20 janvier au 13 mars d’une année non bissextile est de :
![]() Intérêt Exact/exact = 54,707 = 54,71 €
Intérêt Exact/exact = 54,707 = 54,71 €
![]() Intérêt Exact/365 = 54,707 = 54,71 €
Intérêt Exact/365 = 54,707 = 54,71 €
![]() Intérêt Exact/360 = 55,467 = 55,47 €
Intérêt Exact/360 = 55,467 = 55,47 €
![]() Intérêt 30/360 = 56,533 = 56,53 €
Intérêt 30/360 = 56,533 = 56,53 €
La convention temporelle de calcul, encore appelée la base annuelle, participe du calcul de l’intérêt. La détermination du loyer d’un prêt par un taux d’intérêt nécessite d’en préciser la base annuelle.
Une clause de stipulation d’intérêt qui ne contient pas de base annuelle est incomplète et rend le calcul d’intérêt impossible :
intérêt = capital x taux annuel x ? / ?
3. La base annuelle est entrée dans le champ juridique par la jurisprudence [4].
« Vu l’article 1er du décret du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global ;
... il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l’intérêt doit être déterminé par référence à l’année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours, la cour d’appel a violé ce texte ; »
Il aura fallut pas moins de cinq siècles pour que notre droit s’intéresse à la technique financière [5].
Le prêt à intérêt a été successivement interdit sous l’ancien régime, autorisé par la Révolution mais plafonné au taux de l’intérêt légal durant le XIXème siècle pour être libéralisé par la loi du 28 décembre 1966 relative à l’usure et aux prêts d’argent dont l’article 1er stipule :
« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment ou il est consenti, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent... »
Notre droit n’appréhende l’intérêt que pour contenir les excès d’avidité, sans jamais s’y intéresser intrinsèquement et objectivement.
Cette approche usuraire de l’intérêt, par le TEG, marque toujours la jurisprudence de la Cour de cassation et particulièrement de la Première chambre civile dont la quasi totalité des arrêts présente invariablement le taux d’intérêt comme un taux calculé :
« ...le taux de l’intérêt conventionnel ... doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ; » [6]
« ...le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile... » [7]
L’arrêt du 11 mars 2020 n’y déroge pas :
« ...d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile... »
C’est en pratique l’intérêt qui se calcule à partir du taux et non l’inverse, le taux d’intérêt d’un contrat de prêt est une donnée et non un résultat.
La Cour d’appel de Lyon a ainsi pu souligner, à juste titre, que « Le taux conventionnel ne résulte pas d’un calcul mais est librement négocié entre les parties au contrat » [8]. Pareille description du taux conventionnel est toutefois incomplète puisque sans accord sur la base annuelle la rencontre des volontés sur la clause d’intérêt est techniquement imparfaite.
4. La base annuelle est une composante mathématique et juridique de la clause d’intérêt
La consécration juridique de la base annuelle viendra par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du droit de la consommation via la notion de taux débiteur définie comme suit :
« Taux débiteur, le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; » [9]
Si aucun décret n’est à ce jour venu légaliser la formule mathématique d’application du taux d’intérêt au capital sur une base annuelle, il ne fait aucun doute que cette formule est celle exposée supra puisqu’il n’en existe tout simplement aucune autre.
C’est donc par la notion de taux débiteur, c’est à dire du taux d’intérêt complété de sa base annuelle, qu’il devient juridiquement possible de procéder au calcul du prix du loyer.
5. L’année lombarde.
L’année lombarde consiste à calculer le montant d’intérêts journaliers dus par l’emprunteur sur la base d’une année de 360 jours, et non d’une année de 365 ou 366 jours dite « année civile ». Les calculs précités montrent que la différence est sensible et avantageuse pour le prêteur.
La problématique de l’année lombarde tient dans l’utilisation d’une base annuelle défavorable à l’emprunteur à son insu, et dans la juxtaposition de deux bases annuelles sur une même période de temps.
6. Echéances brisées et intérêts intercalaires.
La date de décaissement des fonds par le prêteur intervient rarement précisément un mois avant celle du prélèvement de la première mensualité. Les prêts présentent ainsi la plus part du temps une échéance dite brisée (ou impaire) de plusieurs jours qui est préalable à l’échéance pleine (ou paire) d’un mois complet. Ce peut également être le cas lorsque le prêt est remboursé par anticipation.
La pratique bancaire est de compter sur les échéance brisées des intérêts journaliers souvent nommés « intérêts intercalaires ».
Les clauses d’intérêts intercalaires sont fréquemment le siège d’un calcul d’intérêt journalier sur une base annuelle de 360 jours la plus souvent invisible aux yeux profanes.
7. Le principe d’unicité d’un taux d’intérêt.
Lorsque l’offre ou le contrat de prêt stipule que le taux du prêt est fixe ou constant sur toute la durée du crédit, il s’en déduit nécessairement qu’il est fixe ou constant sur les périodes mensuelles et journalières contenues entre le décaissement du capital et le paiement du dernier euro.
Un conflit de base annuelle peut se produire lorsque le prêt contient également une clause d’intérêts intercalaires sur une base annuelle de 360 jours.
Si tous les intérêts d’un prêt consenti à un professionnel peuvent être calculés sur une base annuelle de 360 jours, il n’y a pas de conflit entre la base annuelle de calcul de l’intérêt mensuel et celle du calcul de l’intérêt journalier.
Mais en revanche lorsque le prêt est consenti à un consommateur, l’utilisation d’une base annuelle de 360 jours pour le calcul des intérêts journaliers entre en conflit avec la base annuelle de calcul des intérêts mensuels qui est toujours l’année civile de 365 ou 366 jours.
Le principe d’unicité du taux d’intérêt, pris dans l’unicité de sa base annuelle ou, plus précisément, dans l’unicité de sa convention de calcul, découle d’une nécessité mathématique des plus simples : s’il est possible d’effectuer une division par 360 ou une division par 365, il est impossible d’effectuer une division par 360 ou 365.
Soit un prêt de 10 000 € dont les intérêts sont au taux fixe de 3,84 %, calculés sur une année civile pour toute la durée du prêt, contenant une clause lombarde d’intérêts intercalaires et débutant par une échéance brisée de 25 jours. Comment calculer les intérêts journaliers de cette échéance brisée ?
Intérêt = 10 000 € x 0,0384 x 25 /(360 ou 365)= ?
D’une part le principe d’unicité du taux d’intérêt (sur une même période de temps) rend l’intérêt de cette échéance incalculable.
D’autre part s’il faut trancher l’incertitude en appliquant à cette échéance brisée le « taux 360 » à titre de condition spéciale et particulière, le prêt n’est plus à taux fixe ou constant mais à taux variable.
Il se côtoie en effet sur les périodes brisées un taux « 365 » et un taux « 360 » qui, s’ils ont tous deux la même valeur numérique, n’en sont pas moins deux modes différents de calcul d’intérêt qui ne conduisent pas au même prix.
Cette situation pourrait être celle décrite par l’article L311-1 du Code de la consommation lorsqu’il présente le taux débiteur fixe comme pouvant être constitué par plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées.
Il faudrait pour ce faire que les deux taux « 360 » et « 365 » soient clairement stipulés dans l’offre ou l’acte constatant un prêt, ce qui n’est pas le cas des clauses lombardes qui n’explicitent pas quelle est la valeur « civile » du taux 360, c’est à dire quel est l’impact sur le taux stipulé en base civile.
8. L’impact sur le taux d’intérêt stipulé.
L’arrêt du 11 mars 2020 retient comme critère de sanction celui de l’impact d’un dixième de point sur le taux stipulé.
L’impact sur le taux stipulé consiste à identifier quelle est le montant du taux d’intérêt qui, en base annuelle civile, produit le même intérêt que le taux en année lombarde.
L’exemple précité révèle que l’utilisation de l’année lombarde sur 25 jours opère conversion du taux d’intérêt de 3,84 % en un taux de 3,89% :
Intérêt 365 = 10 000 € x 0,0384 x 25 / 365 = 26,30 €
Intérêt 360 = 10 000 € x 0,0384 x 25 / 360 = 26,67 €
Intérêt 365 = 10 000 € x 0,0389 x 25 / 365 = 26, 67 €
Dans l’exemple utilisé l’application de la base annuelle de 360 jours a pour effet de « majorer » le taux d’intérêt civil de 0,05 % soit de moins d’un dixième de point (0,1 %).
Une clause de stipulation d’intérêt peut prévoir que le taux ne soit pas fixe sur toute la durée du prêt, mais qu’il varie selon que l’échéance soit brisée ou pleine pour être respectivement de 3,89 % pour les intérêts intercalaires et de 3,84 % pour les intérêts mensuels et ainsi satisfaire aux dispositions de l’article L 311-1 du code de la consommation.
9. Le critère du dixième de point d’impact sur le taux stipulé.
L’écart « supérieur à une décimale » est une transposition à l’année lombarde du seuil de sanction propre au TEG qui est un taux calculé.
Ce critère de l’impact d’un dixième de point, qui participe manifestement d’une volonté de limiter le contentieux, ne contribue pas à la résolution du problème posé par l’année lombarde et ouvre de nouvelles difficultés : il invite à juger qu’un prêt à taux fixe ou constant de 3,84 % permet de calculer l’intérêt d’une période de moins d’un mois au taux civil de 3,85 %, ou 3,86 %, et jusqu’à 3,93 % par manipulation de la base annuelle.
Il semble que la Première chambre n’aie pas mesuré les conséquences stupéfiantes de l’application de ce critère d’un dixième de point sur le taux stipulé puisque cette jurisprudence ouvre la possibilité d’une base annuelle inférieure à 360 jours inconnue du monde financier.
Ce critère de l’impact d’un dixième de point sur le taux stipulé s’articule mal avec une clause d’intérêt à taux fixe ou constant sur toute la durée du crédit qui a été négociée, consentie et stipulée a minima sur deux décimales. Il n’a pas davantage de sens financier.
Le TEG est calculé à partir des données du crédit dont le montant des intérêts et non à partir du taux d’intérêt. Les solutions dégagées pour sanctionner la justesse de ce calcul ne sont pas, par nature, transposables à la clause lombarde qui a pour objet d’altérer la base annuelle civile de la clause d’intérêt et pour effet de majorer le montant des intérêts à l’insu de l’emprunteur néophyte en technique financière.
L’année lombarde n’est pas une erreur de calcul et considérer qu’un taux d’intérêt puisse, à l’instar d’un TEG, être erroné ne peut se concevoir qu’en terme d’erreur sur le mode de calcul de l’intérêt. Ce n’est pas le taux d’intérêt qui est erroné, c’est le taux débiteur qui est désaligné.
Deux taux qui n’ont pas la même base annuelle ne peuvent pas être comparés. Dans l’exemple précité, le taux d’intérêt du prêt est de 3,84 %, mais le taux débiteur des intérêts intercalaires est de 3,89 %.
L’arrêt du 11 mars 2020 doit donc être interprété comme sanctionnant par la déchéance des intérêts l’utilisation de toute base annuelle ayant pour effet d’élever le taux débiteur à plus d’un dixième de point du taux d’intérêt.
10. L’année lombarde est une pratique commerciale trompeuse.
Les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs sont l’objet de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005.
Les articles 6-1-d) et 7-1 définissent comme suit les pratiques trompeuses :
« 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle [...] induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, mêmes si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement :
[...]
d) le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix. » [10]
« 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si [...] elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin [...] pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. » [11]
Dans l’exemple précité, la clause lombarde pourrait être classiquement rédigée comme suit :
« La première échéance est composée d’intérêts journaliers calculés au taux du prêt dans la limite de 30 jours comptés depuis le décaissement des fonds »
L’échéance maximum de 30 jours d’un prêt amortissable par mensualités renvoie à une année de 12 x 30 = 360 jours, les intérêts comptés au jour le jour renvoient à la norme Exact de décompte des nombres de jours entre deux dates : cette clause introduit la convention Exact/360 pour le calcul des intérêts intercalaires.
Alors qu’une rédaction claire et loyale serait :
« Les intérêts journaliers sont comptés pour les échéances de moins d’un mois complet au taux du prêt majoré de 0,05 point » ce qui impose de stipuler dans les conditions particulières du prêt que le taux d’intérêt est de 3,84 % pour les intérêts mensuels et de 3,89 % pour les intérêts intercalaires.
Il est évident qu’une telle rédaction, catastrophique sur le plan commercial, inciterait l’emprunteur à se tourner vers un autre établissement qui pratiquerait une stricte égalité de taux débiteur pour le calcul des intérêts mensuels ou journaliers.
L’article 13 de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs demande aux États membre de prendre au niveau national un régime de sanctions qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Le législateur français a transposé cette directive par la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 qui a institué les articles L 121-1 et suivants du code de la consommation, et particulièrement l’article L 121-2 2° c) lequel stipule :
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
...
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
...
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.
Le seule sanction prévue contre une entreprise dont la pratique commerciale est trompeuse est celle d’un délit puni par l’article L132-2 du Code de la consommation de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €.
Il n’existe en réalité aucune sanction civile contre l’année lombarde et le principe de légalité des peines s’oppose, vu les articles L121-2 et L132-2 du code de la consommation, à ce qu’une juridiction prononce la déchéance des intérêts qui n’est autre qu’une déchéance du prix, sanction non prévue par le code de la consommation en matière de pratique commerciale trompeuse.
11. La sanction de l’année lombarde par la déchéance des intérêts est artificielle.
La question n’est pas nouvelle en soi. Mme Marie-Sophie Richard, conseiller référendaire à la Cour de cassation rapelait en 2004 dans une étude [Les sanctions civiles de nature à assurer la protection des consommateurs en matière de crédit, Cour de cassation Rapport annuel 2004] que la déchéance des intérêts est la seule sanction civile applicable en matière de crédit dès lors qu’elle est prévue par le législateur.
L’arrêt du 11 mars 2020 qui mobilise les articles L 312-8 [12] et -33 du Code de la consommation pour sanctionner l’année lombarde par la déchéance des intérêts force le principe de légalité des peines et de stricte interprétation du droit punitif.
La Première chambre avait observé ce principe :
![]() la déchéance des intérêts ne peut être accompagnée de celle des frais, au motif que ces derniers ne sont pas prévus par l’article L312-33 du Code de la consommation [13] ;
la déchéance des intérêts ne peut être accompagnée de celle des frais, au motif que ces derniers ne sont pas prévus par l’article L312-33 du Code de la consommation [13] ;
![]() la déchéance des intérêts ne peut être prononcée en raison de l’absence de mention dans l’offre des clauses qui sanctionnent l’inexécution du contrat, au motif que cette mention n’est pas imposée par l’article L312-8 [14] ;
la déchéance des intérêts ne peut être prononcée en raison de l’absence de mention dans l’offre des clauses qui sanctionnent l’inexécution du contrat, au motif que cette mention n’est pas imposée par l’article L312-8 [14] ;
La base annuelle de calcul de l’intérêt n’est pas une mention de l’offre de crédit rendue obligatoire par l’article L312-8 et, partant, tant son défaut de mention que la mention d’une base qui n’est pas celle utilisée pour le calcul du TEG devrait être inaccessible à la déchéance de l’article L312-33.
Le formalisme de l’offre de crédit n’est pas adapté à la question de l’année lombarde qui relève du fond du droit pour concerner la détermination du prix au sens de l’article 1591 du Code civil et, le cas échéant, la rédaction loyale ou trompeuse de son mode de calcul.


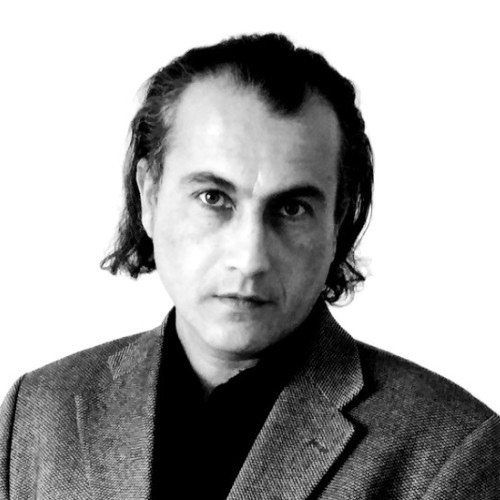




































Discussion en cours :
Cher Maître,
Quand vous écrivez que la consécration juridique de la base annuelle viendra par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du droit de la consommation via la notion de taux débiteur, cette consécration est en fait antérieure de plus de 2 ans.
En effet, toute directive européenne prend effet immédiatement après sa parution au journal officiel. Le juge national n’a pas à attendre sa transposition pour l’appliquer (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61977CJ0106)
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 applicable donc, sans attendre sa transposition, à tous les états membres dès sa parution au JO, dispose que le taux débiteur est "le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé".
Egalement, si vous ne l’avez pas noté, la nouvelle directive omnibus (jo du 18 décembre 2019) prévoit un considérable durcissement des sanctions pour ce qui est des clauses abusives avec l’insertion d’un article 8ter dans la directive 93/13/CEE.
Cordialement,
Julien