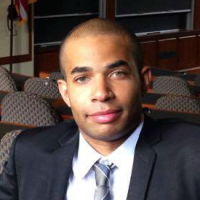Le traducteur juridique se trouve systématiquement confronté à la recherche de l’équivalence entre l’expression de la langue source et celle de la langue cible. Il ne saurait être traducteur juridique sans être également juriste de droit comparé. Or, il s’avère que le traducteur qui n’a pas suivi des études juridiques comparatives s’attelle malgré tout à la traduction au risque d’être taxé de « dilettantisme » ou de ce qu’un auteur a pu qualifier d’« erudicion à vapor » [1]. Pour éviter cet écueil, il est donc opportun de s’imprégner du vocabulaire juridique sans ignorer les règles auxquelles obéit la traduction.
I. L’état des lieux de la traduction juridique.
A l’évidence, la traduction juridique suppose d’une part une solide connaissance du jargon juridique, que les Anglais appellent « legalese », et d’autre part une maîtrise des règles et des principes qui régissent la traduction. A défaut de respecter l’ensemble de ces règles, le traducteur s’expose aussitôt à un double risque.
Tout d’abord, un contrat mal traduit risquerait en effet d’engager sa responsabilité.
Ensuite, une telle démarche ne ferait que nuire à la réputation du traducteur et conforter la thèse selon laquelle l’acte de « traduction » s’apparente en réalité à un acte de « trahison ».
C’est pourquoi avant d’accepter ce mandat et prendre en charge le dossier qui lui est soumis, le traducteur doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.
A. La traduction juridique et le droit comparé.
La traduction juridique en droit comparé consiste à transposer, en remplaçant une expression linguistique par celle d’une autre langue, le contenu juridique d’un terme d’un droit à un autre, de telle sorte que le terme traduit évoque dans la pensée du juriste qui le lit l’image que le concept possède dans le droit originaire et non dans son propre droit [2]. Or, même les traductions linguistiquement correctes peuvent être contestables sur le plan juridique. Il est donc évident que l’on ne peut faire de la traduction juridique sans faire également du droit comparé [3].
La traduction juridique soulève également un certain nombre de difficultés en raison des différences culturelles qui existent entre les systèmes de civil law et de common law. Un tel écart trouve souvent écho dans les choix stylistiques des rédacteurs.
En droit anglais, les formules utilisées sont parfois alambiquées et peu intelligibles, ce qui rend la tâche du traducteur particulièrement difficile. A cet égard, dans l’ouvrage Legal writing and drafting, l’auteur Paul Rylance fustige l’usage de ces termes relevant de l’archaïsme juridique « Lawyers often use archaic phrases quite needlessly. This is largely a result of the traditional training system and the unquestioning habit of lawyers […] When used in drafting, these expressions create a false impression of precision when in reality they conceal lazy thinking » [4].
B. Le vaste univers de la traduction.
De manière générale, la traduction a un champ de recherche qui lui est propre sans être pour autant une science exacte [5]. A cet égard, il n’est pas de modèle idéal de traduction. La traduction s’achève à partir d’éléments de langage et de contexte. De ce fait, il est des traductions justes qui ne se valent pas, tout comme il est de bons et de mauvais traducteurs.
Du point de vue pratique, l’univers de la traduction comporte toujours deux composantes : l’action de traduire, et le résultat de l’opération. Autrement dit, il existe une traduction-action et une traduction-produit [6]. Or, cet exercice présente un certain nombre d’écueils que tout traducteur devrait connaître.
Tout d’abord, le traducteur ne devrait pas céder à la tentation d’opérer des choix stylistiques qui iraient à l’encontre de ce que suggère le texte source. S’il est des ambiguïtés, celles-ci devraient demeurer dans le texte d’arrivée.
Ensuite, le traducteur ne devrait pas faire fi des aspects psychologiques et émotionnels liés aux choix des mots et aux images qu’ils évoquent dans l’esprit du lecteur. Dans le cas contraire, la fidélité de la traduction s’en trouverait irrémédiablement affectée.
L’acte de traduction est donc particulièrement complexe en dépit de la définition réductrice que les dictionnaires nous offrent [7].
Ainsi, il n’est pas inutile de relever qu’en dépit des avancées de la technologie, la traduction est avant tout une opération humaine, et devrait rester indéniablement entre les mains des spécialistes.
II. Les enjeux de la traduction juridique.
Les enjeux de la traduction juridique sont nombreux. Ils ont trait à la relation avec le client, à la nature des documents à traduire, aux choix à opérer dans la traduction juridique et aux spécificités du jargon juridique. La traduction est aussi un procédé intellectuel subversif en ce qu’il confère une valeur absolue à la transformation de la pensée [8].
Il incombe donc au traducteur de restituer le sens d’un texte tout en respectant les choix stylistiques de l’auteur. Or, la pratique montre également que la traduction est un exercice qui a ses propres limites.
En effet, la traduction juridique, très codifiée par nature, restreint considérablement la latitude du traducteur et exige de lui un haut niveau d’expertise dans le domaine juridique.
Le traducteur juridique ne saurait entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé, sans obtenir l’assistance ou l’information nécessaire. En effet, il n’existe pas de traduction parfaite. Il existe, en revanche, des traductions incontestables quoique différentes entre elles. C’est pourquoi un auteur a pu employer une formule particulièrement évocatrice en estimant que : « La traducciön es el permanente flou literario » [9].
A. Le traducteur juridique et le client.
Lors du premier contact avec le client, il est nécessaire de comprendre ses attentes. Pour ce faire, le traducteur se doit d’être à l’écoute des besoins du client et rester objectif sur la viabilité du projet de traduction qui lui est soumis. Ainsi, il ne devra pas hésiter, si cela se révèle indispensable, à rediriger le client vers d’autres collègues traducteurs plus compétents ou plus expérimentés dans ce domaine, ou encore disposant d’un temps de travail suffisant pour mener à bien la traduction.
Le traducteur doit aussi se poser toute une série de questions : est-ce la première fois que le client a recours aux services d’un traducteur ? A-t-il eu recours à nous dans le passé ? A quel usage la traduction est-elle destinée ? A quel type de démarche doit lui servir la traduction ? Pour quand le client a-t-il besoin de son document ?
Ceci étant précisé, il arrive parfois que certains clients mettent en cause les difficultés objectives que suscite la traduction. Or, il va de soi que le client n’est pas (nécessairement) le mieux placé pour juger de la complexité (réelle ou supposée) de la traduction.
B. La nature des documents à traduire.
La nature du document varie non seulement en fonction du type de démarche à effectuer mais aussi en fonction du profil de client (cabinets d’avocats, entreprises, particuliers, etc.). Les documents peuvent être notamment : les actes d’état civil (acte de mariage, acte de décès, actes de naissance, certificats de célibat), les statuts de sociétés, les correspondances des avocats, les décisions de justice, les assignations, les relevés de notes, les diplômes, les avenants, les contrats, les fiches de paie, les articles de presse, les attestations, les apostilles, les casiers judiciaires, les demandes d’asile, les titres de séjour, les mandats d’arrêt, les permis de conduire, les témoignages, les testaments, pour ne citer que les plus courants. Chaque type de document présente un intérêt particulier et exige un traitement spécifique.
A ce propos, les objectifs de la traduction d’un jugement ne sont pas les mêmes que ceux de la traduction d’un acte d’état civil. En effet, si les règles auxquelles obéit la traduction restent les mêmes, la nature du document impose un modus operandi qui varie en fonction du document à traduire.
C. Les choix à opérer dans la traduction juridique.
Dans la traduction, les termes et les expressions choisis évoquent des images dans l’esprit du lecteur. C’est pourquoi le traducteur juridique se doit d’être prudent dans l’emploi des mots au regard de la charge émotionnelle que les termes véhiculent. En d’autres termes, il doit se soucier tout particulièrement de la sensibilité du destinataire de la traduction. Méconnaître ces précautions ou en faire l’économie reviendrait, selon Victor Hugo, à faire « un coup de brutalité comme le soleil entrant brusquement dans une chambre sans rideaux » [10].
Or, il est des écueils qui ne tiennent pas à la sensibilité du lecteur mais plutôt à la théorie et à la pratique de la traduction. A cet égard, il est des mots et des expressions qui souffrent d’une intraductibilité totale ou d’une traductibilité partielle. En effet, il n’est pas rare que des traducteurs expérimentés ou des juristes linguistes expriment des réserves quant à certains choix de traduction. Ainsi, un éminent juriste comparatiste italien Rodolfo Sacco doute : « que le mot « chariia » soit bien traduit lorsque les Français parlent de « droit islamique ». En outre, les mêmes mots n’ont pas toujours la même valeur sur toutes les lèvres. [11]
Cet exemple illustre que certains choix du traducteur sont souvent empreints de pragmatisme d’une part, et témoigne de la désinvolture qui guide parfois le modus operandi du traducteur d’autre part. A cet égard, il montre les pièges que nous tend régulièrement l’activité traduisante.
C’est pourquoi le traducteur se doit de mener une réflexion plus poussée sur les pistes de traduction qui peuvent s’offrir à lui. Dans le contexte juridique, il est fortement déconseillé de traduire les termes qui concernent les juridictions étrangères, pour lesquels il n’existe pas d’équivalence. Si un arrêt a été rendu par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, il conviendra de laisser les noms des juridictions en l’état. En revanche, si la traduction du nom de la juridiction ne soulève pas d’ambiguïté elle ne prêtera pas non plus le flanc aux critiques. Il sera donc possible de traduire Court of Appeal par Cour d’appel et High Court of Justice par Haute Cour de Justice.
En revanche, il se peut que le traducteur ne trouve pas de pistes de traduction. Un exemple concret dans les actes d’état civil est l’expression « Notary Public » qui ne correspond pas à la notion de « notaire » en droit français [12].
En tout état de cause, le client ne saurait avoir voix au chapitre, n’étant pas (nécessairement) en mesure de comprendre les enjeux liés à la traduction juridique. Toutefois, il est parfois nécessaire de faire un choix stratégique ou conciliant afin de rassurer le client sans pour autant méconnaître les exigences formelles qu’impose l’administration.
D. Les spécificités du jargon juridique.
« Many things converge to create overlong sentences in legal writing. One is overparticularization – the wreched habit of trying to say many things at once, with too much detail and too little sense of relevance. » [13]
Dit autrement, les textes juridiques sont souvent très mal rédigés, ce qui ne facilite pas la tâche du traducteur. Or, le traducteur se doit de laisser en l’état toutes les ambiguïtés qui figurent dans le document qui lui est soumis au risque de trahir la volonté du rédacteur.
Pourtant, il est des auteurs qui conviennent de la nécessité de rendre le propos du texte source plus clair et plus concis dans le texte d’arrivée. Sur ce point, le professeur Jean Kerby [14] est d’avis que : « Le traducteur a intérêt à recomposer la longue phrase anglaise en phrases plus courtes : il en a d’ailleurs le droit, vu qu’il n’est nullement lié ici par le style de l’original. N’étant pas non plus lié par la ponctuation du texte de départ, il doit tirer parti de la ponctuation française pour donner toute la clarté possible au produit fini. De toute façon, il faut, ici comme partout, tenir compte du domaine, du genre et de la destination. » [15]
Ce type d’expertise requiert une longue pratique et une formation préalable, celles-ci étant naturellement étrangères aux profanes. La traduction est donc un univers difficile à appréhender. Il s’agit en effet d’un univers qui se traverse par un « exil » et un « retour ».
C’est pourquoi le traducteur s’y plonge avec une certaine prudence sans pour autant éluder les risques liés à l’activité traduisante. Ainsi, comme nous le relate un auteur en citant Victor Hugo « Les traducteurs sont les ponts entre les peuples... Ils transvasent l’esprit humain de l’un chez l’autre. C’est par eux que le génie d’une nation fait visite au génie d’une autre nation... » [16].