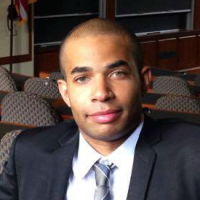Avant d’être lanceur d’alerte et fervent militant, Julian Assange est journaliste, programmeur de logiciels, expert en cryptographie, spécialisé dans les systèmes conçus pour protéger les défenseurs des droits de l’homme.
Il est désormais incarcéré dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, à Londres, depuis son arrestation à l’Ambassade de la République d’Équateur au mois d’avril 2019 alors qu’il avait obtenu l’asile diplomatique en 2012. Il y a passé sept ans afin d’éviter d’être extradé vers les États-Unis d’Amérique où il risque 175 ans de prison pour diffusion de documents confidentiels, si tant est que la justice fédérale américaine refuse de lui réserver la peine de mort que la loi prévoit pour les crimes tels que l’espionnage [1]. En mai 2019, Assange a été condamné à près d’un an de prison par la justice britannique pour violation des termes de sa liberté conditionnelle.
Sur le plan international, sa démarche plonge les politiques dans le plus grand embarras. Sa personne devient ainsi l’objet de vives critiques. C’est dans ce contexte, qu’aux États-Unis d’Amérique, la secrétaire d’État, Hillary Clinton, dénonçait une « attaque contre les intérêts diplomatiques américains » [2]. En France, dans une interview donnée au journal Le Monde, Michèle Alliot-Marie, ministre française des Affaires étrangères, jugeait « ces révélations totalement irresponsables », les condamnait « sans aucune restriction », car « révéler des documents diplomatiques, c’est une atteinte à la souveraineté des États » [3].
En tout état de cause, il s’agit de la fuite d’informations confidentielles la plus massive de l’histoire du journalisme. A cet égard, les responsables du site WikiLeaks (littéralement « fuite de documents confidentiels »), en particulier son fondateur, Julian Assange, avaient rendu public plus de 700.000 documents confidentiels et notamment près de 250.000 télégrammes diplomatiques (TD) américains.
Les États-Unis d’Amérique voient donc en Julian Assange une menace pour leur sécurité intérieure en méconnaissant l’importance de la liberté d’expression et d’information dont disposent les lanceurs d’alerte.
I. La liberté d’expression des lanceurs d’alerte.
L’appareil de surveillance déployé par les agences de renseignement américaines sur les réseaux de télécommunications est remis en question par les résistants de la démocratie virtuelle. Les documents dévoilés par WikiLeaks seraient particulièrement sensibles au point de bouleverser les équilibres politiques internationaux.
Or, c’est bien la criante asymétrie d’information qui existe entre les pouvoirs publics et les citoyens et qui profite aux États qui a forgé le cyber-militantisme du fondateur de WikiLeaks. A cet égard, WikiLeaks affirme que « les principes généraux sur lesquels notre travail s’appuie sont la protection de la liberté d’expression et de la diffusion par les médias, l’amélioration de notre histoire commune et le droit de chaque personne de créer l’histoire. Nous dérivons ces principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme ».
A. La notion de « lanceurs d’alerte ».
La protection des lanceurs d’alerte tient à leur liberté d’expression et d’information. L’alerte concerne la révélation d’informations sur des activités qui constituent une menace ou un préjudice pour l’intérêt général [4].
En effet, les « lanceurs d’alerte » sont des individus qualifiés en anglais de whistleblowers (littéralement, « ceux qui donnent un coup de sifflet ») ou parfois de leakers (« sources de fuites »). L’expression « lanceur d’alerte » est apparue dans les années 1990 sous la plume des sociologues Francis Chateauraynaud et Didier Torny dans le cadre d’un programme de recherche du CNRS sur le thème des « prophètes de malheur ».
Cependant, d’aucuns préfèrent définir le « lanceur d’alerte » comme celui qui signale ou divulgue plutôt que comme un délateur. En effet, l’expression de « lanceur d’alerte » aurait pour mérite de légitimer certaines divulgations faîtes au nom de valeurs nobles tandis que la délation est une forme de dénonciation qui obéit à des motivations méprisables [5]. D’ailleurs, il convient de relever que là où la dénonciation veut nuire, le signalement veut sauver [6]. De plus, le terme « fuiteurs » est une traduction littérale de l’anglais « leakers », préfigurant le terme de « WikiLeaks ».
B. La protection juridique du lanceur d’alerte.
La protection juridique du lanceur d’alerte diffère d’un pays à l’autre. En droit européen, au-delà de l’adoption de la résolution sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne [7], le dispositif reste plutôt lacunaire.
En France, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », prévoit un même statut pour tous les lanceurs d’alerte, leur l’immunité pénale en cas de divulgation de certains secrets protégés, et un droit d’agir au pénal contre l’auteur de représailles consécutives à une alerte.
L’article 6 de cette loi désigne le lanceur d’alerte comme étant : « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».
En revanche, la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement n’a pas entendu faire reculer la protection du secret et du caractère confidentiel en matière de défense et de sécurité. La « communauté française du renseignement » peut continuer de s’en prévaloir pour agir, mais doit aussi respecter cet impératif dont le non-respect est punissable [8].
En effet, en matière de renseignements et dès lors qu’il s’agit de protéger la vie privée, un mécanisme d’alerte est prévu dans le Code de la sécurité intérieure.
La loi Sapin II exclut également le secret de défense nationale du champ de la protection des lanceurs d’alerte (avec le secret médical et celui entre l’avocat et son client) ce qui confirmerait qu’il est un « secret absolu inconciliable avec un droit d’alerter » [9].
En tout état de cause, la protection des lanceurs d’alerte pourrait relever de l’article 4 du préambule de la Constitution de 1946, qui prévoit que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.
En France, le Défenseur des droits est désigné comme l’autorité en charge de la protection des lanceurs d’alerte. Or, la loi ne traite pas spécifiquement le cas des lanceurs d’alerte étrangers, notamment pour le cas où la France serait bénéficiaire des informations divulguées.
Indépendamment de la protection juridique, WikiLeaks est conçu de telle sorte que les lanceurs d’alerte sont anonymes. On ne sait pas d’où vient l’information et ce afin de les protéger [10].
C. La protection juridictionnelle des lanceurs d’alerte.
La jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg en matière de liberté d’expression des lanceurs d’alerte fait varier l’intensité de son contrôle selon le type d’informations signalées : « Plus les irrégularités dénoncées mettent en jeu l’intérêt public, plus l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant sera appréciée avec rigueur » [11].
La Cour s’assure ainsi que les juridictions étatiques prennent en considération l’utilité pour les citoyens d’être informés des faits dénoncés. En effet, dans toute société démocratique, il convient de garantir l’expression des idées, peu important que ces idées choquent, heurtent ou inquiètent [12].
La Cour européenne des droits de l’homme a encadré la protection des lanceurs d’alerte pour la première fois dans l’affaire Guja contre Moldavie en 2008 [13].
Ainsi, elle estime que « l’intérêt de l’opinion publique pour une certaine information peut parfois être si grand qu’il peut l’emporter même sur une obligation de confidentialité imposée par la loi » [14].
Elle a donc donné gain de cause à l’agent du ministère public moldave qui avait révélé dans la presse des documents relatifs à des faits de corruption dont il avait été saisi, et ce tout en reconnaissant la nécessité pour l’État d’imposer une « obligation de discrétion très stricte » [15].
La Cour arrête également différents critères qui président à la protection des agents lanceurs d’alerte sur le fondement de la liberté d’expression prévue à l’article 10 CEDH.
Parmi ces critères [16], et conformément à la logique de priorité de l’alerte interne, la Cour estime que la divulgation doit d’abord être portée auprès du « supérieur ou d’une autre autorité ou instance compétente. La divulgation au public ne doit être envisagée qu’en dernier ressort, en cas d’impossibilité manifeste d’agir autrement », c’est-à-dire « s’il disposait d’autres moyens effectifs de faire porter remède à la situation qu’il jugeait critiquable » [17]. Cette règle est celle de la « dénonciation par palier » [18].
Or, ce type d’exigence est susceptible de nuire à la circulation d’une information d’intérêt général et d’exposer l’auteur à des risques relatifs à son intégrité physique et à sa vie personnelle. C’est pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme se montre sévère quant aux sanctions infligées aux lanceurs d’alerte, prévenant qu’« un système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité nationale comporte le risque de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre » [19].
D. Julian Assange : apôtre de la transparence de l’information.
Julian Assange est l’un des premiers à mettre en œuvre l’utilisation d’Internet et de la cryptographie afin de divulguer systématiquement et anonymement des secrets d’État [20].
En ce sens, les lanceurs d’alertes font figure d’« apôtres » ou de « héros de la transparence », en contribuant au renouvellement de la démocratie dans une optique participative [21]. Cette démarche emprunte à une nouvelle forme de militantisme et s’inscrit dans un mouvement plus large qualifié de hacktivism. Ce terme est en effet la synthèse des mots hacker et actvism, et illustre la fusion entre piraterie virtuelle et le militantisme éclairé.
La fuite de documents classifiés n’est pas nouvelle si l’on songe à l’importance qu’ont eue les Pentagon Papers [22] ou plus récemment les Panama Papers. Quoi qu’il en soit, cette fuite de documents classifiés produit involontairement de la transparence et normalise les comportements humains avant toute dénonciation.
C’est pourquoi Assange estime que la transparence pousse les acteurs à se comporter vertueusement. Il a pour cela été appelé « le prophète d’un âge à venir de transparence involontaire » [23] .
En effet, Assange, plus que quiconque, a montré que le monopole de l’information et de la connaissance par une minorité oligarchique ne peut être permanent. C’est la raison pour laquelle au milieu des années 1990, il crée un système crypto-graphique destiné à protéger dissidents et défenseurs des droits de l’homme à travers le monde.
Cependant, il serait naïf de croire que le secret disparaît à cause de la transparence numérique. En effet, d’après le Washington Post, le nombre de documents classés « secrets » aux États-Unis d’Amérique a explosé entre 1996 et 2009, passant de 5,6 millions à... 54,6 millions [24].
Ce n’est qu’en 2010 que WikiLeaks est devenu un point de focalisation du débat public : en avril de cette année-là, l’organisation dévoilait la vidéo Collateral Murder, qui montrait des civils irakiens (y compris des journalistes et des enfants) se faire tuer lors d’une attaque aérienne américaine [25].
En avril 2011, WikiLeaks rendait disponible une série très médiatisée de documents concernant le mauvais traitement des détenus sur la base militaire états-unienne de Guantanamo.
Ceci étant dit, les maigres ressources financières que WikiLeaks tirait de donations ont été brutalement arrêtées à la suite d’un blocus financier organisé par le département d’État américain [26].
Cependant, en dépit de la démarche offensive des États-Unis d’Amérique, un standard international émergent instaurant une exception d’intérêt public au profit des lanceurs d’alerte pourrait permettre de protéger ceux qui voient en Julian Assange un modèle à suivre [27].
II. Les limites de la liberté d’expression des lanceurs d’alerte.
Le secret ainsi que la censure s’opposent à la liberté d’expression. Or, si Assange lutte contre la censure il ne nie pas l’importance du secret. En effet, il s’oppose au secret seulement lorsque celui-ci renforce à l’excès l’asymétrie d’information au profit des autorités étatiques.
A. La tyrannie du secret.
Assange connaît parfaitement les implications de ses révélations. A cet égard, conscient de la nécessité du secret, il en apprécie les vertus lors d’un entretien : « Le secret est important pour beaucoup de choses, mais ne devrait pas être utilisé pour couvrir les abus. Cela nous conduit à la question de savoir qui décide et qui est responsable. En effet, la question ne devrait pas être “Faut-il maintenir le secret sur quelque chose ?” Je crois plutôt qu’il faudrait se poser la question : “Qui a la responsabilité de garder certaines choses secrètes ? Et, qui a la responsabilité de dévoiler ces mêmes choses devant le public ? Ces deux types de responsabilités incombent à des acteurs différents. Et il est de notre responsabilité de dévoiler ces sujets au public » [28].
Autrement dit, le secret est important mais devrait céder face à la divulgation dès lors que les informations sont d’intérêt général.
Ainsi, le site WikiLeaks affiche sur sa page d’accueil le message suivant pour expliciter sa mission : « Publier augmente la transparence, et la transparence crée une meilleure société pour tous. Une vigilance scrupuleuse mène à moins de corruption et à plus de démocratie, et cela dans toutes les institutions, que ce soient les gouvernements, les entreprises ou d’autres organisations » [29].
Son action, si subversive soit-elle, répond à un besoin criant de démocratie.
Plus précisément, WikiLeaks prône la transparence des puissants et la vie privée pour les autres, ce qui explique pourquoi la persécution dont fait l’objet son fondateur, Julian Assange ne cesse de perdurer. Or, il convient de rappeler que ce site a révélé d’importants scandales de corruption. En 2009, le site a révélé certains mécanismes de corruption au Kenya. Pour cette initiative, Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, a obtenu le prix Amnesty International (New Media).
B. Une démocratie embarrassée.
Assange nous livre une métaphore qui fait écho à cette recherche subversive d’une démocratie délivrée de tous ses simulacres : « Quand on appréhende une conspiration autoritaire comme un tout, nous voyons un système d’organes en interaction, une bête avec des artères et des veines dont le sang peut être épaissi et ralenti jusqu’à ce qu’il tombe, stupéfait ; incapable de suffisamment saisir et de contrôler les forces de son environnement » [30].
WikiLeaks serait ainsi un élément de contrôle sur les décideurs. En Démocratie, tout pouvoir nécessite un contre-pouvoir. Or, Assange souhaite y ajouter une dimension éthique : « La première victime de la guerre c’est la vérité, les atteintes à la vérité commencent avant la guerre et se poursuivent après la guerre » [31].
Cette vision n’est pas partagée par le Pentagone qui estime que la démarche de transparence absolue est génératrice de désordre, voire de conflits, tandis que les hacktivists de WikiLeaks proclament qu’il s’agit de créer les conditions d’un monde sans guerre [32].
Force est de constater que l’embarras que suscite la révélation d’informations confidentielles oblige ceux qui en contestent la légitimité à en diaboliser aussitôt la source. A cet égard, un député du Congrès américain a pu déclarer que « WikiLeaks paraît répondre aux critères juridiques d’une organisation terroriste » [33]. De même, la députée Candice Miller publiait une déclaration disant : « La dernière sortie dans la presse de documents volés prouve encore une fois que l’organisation WikiLeaks constitue une opération terroriste » [34].
De ce fait, les gouvernements ont commencé à exercer une forte pression sur les institutions financières telles que Visa, Mastercard, PayPal afin qu’elles bloquent l’acheminement de dons à WikiLeaks. Ce blocus financier a donc forcé l’organisation à suspendre temporairement ses opérations au point de menacer son existence même.
L’organisation possède néanmoins de nombreux partisans, comme la communauté de hackers structurée autour de la mouvance « Anonymous » qui, en représailles contre l’attitude de certaines institutions financières, a effectué des attaques par « déni de service » [35].
C’est dans ce contexte que le cyber-anarchisme monte en puissance [36]. En effet, pour ce mouvement, le Web devient un instrument d’affaiblissement ou de dissolution des institutions qui sont désormais réputées inutiles voire nuisibles aux citoyens.
La circulation de l’information à grande échelle est donc un vecteur de subversion politique en ce sens que la conception pyramidale de la démocratie s’effrite au profit d’une connaissance authentique irradiant la société dans son ensemble.
A ce titre, Assange nous rapporte que : « Nous pouvons tromper ou aveugler une conspiration en distordant ou en restreignant les informations dont elle dispose. Nous pouvons réduire le pouvoir total de la conspiration en attaquant ses liens, même de manière non structurée, ou en cassant le réseau en parties séparées. Une conspiration ainsi attaquée n’est plus en mesure de comprendre son environnement ni de planifier une action vigoureuse » [37].
Or, une telle approche ne s’apparente pas à un conspirationnisme primaire mais plutôt à la revendication d’une forme de démocratie dans laquelle l’information et la connaissance se manifestent de manière diffuse. C’est pourquoi Assange fustige la démarche des barons de la Silicon Valley en affirmant que : « Facebook en particulier est la machine d’espionnage la plus épouvantable qui ait jamais été inventée. [...] Facebook, Google, Yahoo – toutes ces grandes firmes américaines ont des interfaces spécialement fabriquées pour les renseignements des États-Unis. Il ne s’agit pas ici d’une procédure d’assignation. Ils ont développé une interface spécifiquement pour les Services de renseignements états-uniens » [38].
En conclusion, Assange est au nombre des résistants du monde virtuel. Il est de ceux qui se sont illustrés dans le mouvement de désobéissance civile au même titre que Rosa Parks, Martin Luther King Jr. [39] ou encore plus récemment Edward Snowden.
Dans ce contexte, la communauté internationale, forte d’une indolence coupable, détourne son attention d’un visage humain qui arbore consternation et affliction. Ainsi, sous couvert d’une prétendue droiture intellectuelle, ses détracteurs se risquent à étouffer brutalement une voix qui les indispose. Pour eux seulement, celle-ci compte comme une voix dissonante de la leur. Or, cette voix est surtout celle d’un incompris, d’un justicier, d’un martyr de la liberté, d’un homme méritant qui tient lieu d’exemple. Son sort, pour tourmenté qu’il soit, est un appel à un sursaut de conscience et de courage. Dans ce monde, sa voix semble pourtant résonner étrangement comme si elle émanait d’un infirme qui prêchait vertueusement dans le désert, alors qu’en son absence, notre droit à la connaissance ne serait rien d’autre qu’un espoir trahi.