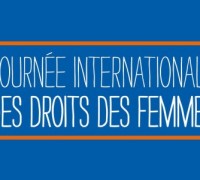Association française des femmes juristes (AFFJ).
Avec Marie L’Hermite et Claire Poirson, respectivement présidente et vice-présidente de l’AFFJ.

- Marie L’Hermite et Claire Poirson.
Si vous deviez présenter votre association en quelques lignes ?
Fondée en 2000 à l’initiative de Me Dominique de La Garanderie, première femme Bâtonnière du Barreau de Paris, et d’un groupe de femmes exerçant des fonctions de responsabilités et ayant chacune fait preuve de compétence et de réussite dans leur profession respective, l’AFFJ regroupe des juristes de tous les horizons : professeures de droit, juristes d’entreprises, conseillères d’État, notaires, magistrates, avouées, avocates, commissaire de justice et étudiantes en droit.
À caractère apolitique, l’AFFJ a pour but de veiller à l’effectivité du droit des femmes et de l’égalité femmes/hommes, promouvoir les femmes dans les organisations et instances, tant nationales qu’européennes et internationales, ainsi que dans leurs activités professionnelles respectives, renforcer les liens et les échanges avec les femmes juristes européennes et internationales, contribuer aux actions et aux politiques menées dans l’Union Européenne pour la reconnaissance, la promotion et le respect du droit des femmes.
La force de l’AFFJ réside dans sa diversité d’expertises, son ouverture et sa dimension transgénérationnelle, nos membres couvrant toutes les générations de 20 à 80 ans.
Comment à son niveau fait-elle avancer les droits des femmes ?
« L’AFFJ s’empare de tous les sujets de sociétés ayant un impact sur l’égalité femmes hommes. C’est au travers de ses diners-conférences, ateliers, webinars et participations aux évènements extérieurs que l’AFFJ aborde de nombreux sujets sous le prisme du droit comme outil de régulation ».
Que vous évoque le thème choisi par l’ONU pour cette journée des droits des femmes 2025 : “Pour TOUTES les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation” ?
« Cela dépend aussi de la région du monde où l’on se situe. Dans de nombreux pays, la loi pourrait venir au secours de jeunes filles en interdisant notamment la mariage forcé /mariage de mineur, les mutilations, l’accès à l’école/l’éducation. Certains pays développés sont aujourd’hui en phase de “sous-développement” concernant le droit des femmes avec un recul de ces droits – au premier rang desquels le droit à l’avortement. Le consentement est également un sujet de droit. L’éducation à la sexualité des jeunes est déterminant pour leur permettre de prendre conscience et de comprendre cette notion.
“Droits, égalité et autonomisation” pourraient être atteints si l’on laissait les femmes disposer librement et en sécurité de leurs corps. Un pays où les femmes ne sont pas libres est un pays où un homme ne sera jamais libre non plus. Il est temps que les hommes comprennent que la liberté et les droits des femmes sont un sujet d’humanité avant tout ».
Quelle est la place de la sororité pour défendre et faire progresser les droits des femmes ?
La sororité est importante au sein des réseaux professionnels comme au sein de l’AFFJ, il s’agit d’entraide, d’écoute. Cette sororité nous permet aussi d’agir de concert, de mettre en commun nos forces pour atteindre un objectif. Sans 2GAP [1] et sans l’aide des femmes du public, nous n’aurions jamais pu atteindre un tel résultat avec la Loi Rixain [2] suivie de la Loi Billon pour le secteur public. Ce n’est pas qu’une question de sororité, mais de bon sens : nous poursuivons le même objectif qui est l’égalité des droits.
Au-delà des réseaux professionnels féminins, la sororité s’exprime aussi pour exfiltrer des femmes (juristes ou non d’ailleurs) d’Afghanistan ou d’Iran. Nous nous organisons en faisant appel à différents réseaux de femmes.
En regroupant 90 réseaux féminins du public et du privé au sein de 2GAP nous décuplons le concept de sororité – nous en faisons une stratégie, un maillage dans toutes les strates de la société au service des droits des femmes.
Femmes et Droit.
Avec Mathilde Jouanneau, présidente de l’association Femmes et Droit.

- Mathilde Jouanneau.
Si vous deviez présenter votre association en quelques lignes, que diriez-vous ?
« Femmes et Droit a été créée en 2008 dans le but de promouvoir la place des femmes dans les institutions représentatives des avocats et ainsi présenter des candidates aux élections du Conseil National des Barreaux (CNB) et du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris (CO).
L’objet de notre association est de lutter contre la discrimination faites aux avocates dans l’exercice de leur profession et d’agir pour favoriser leur intégration et leur maintien pérenne dans les barreaux français et dans les barreaux étrangers.
Elle contribue et soutient la transversalité des approches et les actions interprofessionnelles.
Actuellement, elle se rapproche d’associations de femmes notaires, expertes comptables pour œuvrer à l’indépendance économique des femmes ».
Comment à son niveau fait-elle avancer les droits des femmes ?
« Association professionnelle, elle a joué un rôle majeur dans la féminisation des conseils de l’ordre et du CNB.
Elle a participé activement à la mise en place de la parité au sein des différentes institutions de la profession.
Si le combat pour la parité au sein des institutions représentatives a été gagné, le Bâtonnat reste encore à conquérir. Les femmes bâtonnières et plus particulièrement à Paris se comptent encore sur les doigts d’une main !
Les avocates en France sont plus nombreuses aujourd’hui que leurs homologues masculins. En nombre, mais pas en chiffre d’affaires ni en longévité ! Beaucoup d’entre nous quittent la profession faute d’évolution après quelques années de barre, c’est sur ce sujet qu’il faut maintenant avancer ».
Que vous évoque le thème choisi par l’ONU pour cette journée des droits des femmes 2025 : “Pour TOUTES les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation” ?
« La question de l’égalité passe par l’autonomisation.
Beaucoup de femmes sont encore dépendantes économiquement ou juridiquement des hommes, tant dans leur vie privée que dans la sphère professionnelle.
Cette autonomisation est essentielle et doit être transmise aux filles (mais aussi aux garçons). Elle est un sujet majeur de notre société ; notre société qui faisait mine il y a 20 ans de croire que l’égalité était acquise et que le féminisme était un combat dépassé.
La revendication des femmes et de leur indépendance, de leur corps et de leur esprit, ces dernières années en France comme à l’étranger a démontré qu’il s’agissait d’un combat d’actualité et toujours présent dans la société du 21e siècle ».
Quelle est la place de la sororité pour défendre et faire progresser les droits des femmes ?
« Femmes et droit est composée de femmes avocates.
L’association a, un temps, intégré des hommes, notamment pour présenter des listes paritaires lors d’élections dans les instances représentatives. Mais en réalité, les hommes n’ont pas été très actifs au sein de l’association, c’était finalement, je crois, une erreur. Femmes et Droit n’était pas leur lieu pour militer à nos côtés pour l’égalité.
Il y a un réel besoin de se retrouver entre femmes et en l’espèce entre avocates pour parler, réfléchir et avancer sur les droits des avocates.
Je crois donc à la force de la sororité, mais sans naïveté. Ma sœur n’est pas ma semblable en tout point.
Je suis persuadée que la sororité s’active quand l’une d’entre nous est en difficulté, je suis moins sûre de sa force quand il s’agit de partager le pouvoir... Aux femmes de prouver le contraire et l’humanité aura fait un grand pas vers la solidarité ».
Le pôle Droit des femmes de la Clinique Juridique de la Sorbonne.
Avec Sara Radisavljevic et Philippine Gauchard, Étudiantes et Cliniciennes du pôle droit des femmes de la clinique juridique de la Sorbonne.

- Sara Radisavljevic et Philippine Gauchard.
Pouvez-vous nous présenter le pôle Droit des femmes de la Clinique Juridique de la Sorbonne et les raisons de sa création ?
« La création en 2018 du pôle Droit des femmes au sein de la Clinique juridique répond à une demande croissante des requérantes sur des questions d’égalité des genres, de discriminations et de droits des femmes dont la traduction sur le plan juridique n’est pas toujours aisée. En ce sens, le faible nombre de cas reçus par an traduit la difficulté rencontrée par les femmes à faire appliquer le droit aux situations qu’elles rencontrent. Un des objectifs de la clinique est de démocratiser l’accès au droit. Ainsi, le pôle Droit des femmes sensibilise les étudiant(e)s sur ces sujets par le biais de conférences organisées régulièrement. Sont également menées des actions concrètes qui permettent de former les étudiant(e)s par la consultation juridique, mais également par la possibilité de rejoindre le réseau entretenu par le pôle avec divers acteurs, notamment des associations féministes [3] ».
Que vous évoque le thème choisi par l’ONU pour cette journée des droits des femmes 2025 : “Pour TOUTES les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation” ?
« Ce thème prône un féminisme intersectionnel, où l’inclusion est le mot d’ordre. Il met ainsi en avant l’importance de prendre en compte les discriminations subies par les minorités, qu’elles soient liées à la religion, le handicap, l’orientation sexuelle, la couleur de peau.
Il rappelle la nécessité de défendre un féminisme qui ne se contente pas de défendre uniquement les intérêts de certaines femmes, mais qui s’engage à être une arme pour toutes.
Les termes de droits et d’égalité rappellent que les droits des femmes sont constamment en danger, notamment en temps de conflits ou par un retour du conservatisme dans plusieurs régions du monde. Il faut également prendre des mesures pour assurer une application effective de l’égalité et des droits et tendre à la suppression des obstacles structurels qui rendent difficile cette application tant ils sont intériorisés.
L’autonomisation comme moyen d’émancipation, tant sur le plan économique que juridique, est mise en valeur cette année. Un rapport de l’ONU démontre l’importance de renforcer l’autonomisation pour aspirer à terme à une réduction des violences subies par les femmes.
Pour finir, associer les filles aux femmes permet d’inclure les plus jeunes, qui sont en proie aux violences sexistes et sexuelles dès le plus jeune âge, mais aussi à des formes d’exploitation et qu’il faut protéger ».
Comment défendre les Droits des femmes en 2025 ?
« Défendre les droits des femmes en 2025 requiert une approche intersectionnelle sur plusieurs fronts. Sur le plan social, il est indispensable de sensibiliser dès le plus jeune âge en valorisant les expériences diverses des femmes. Politiquement, des politiques publiques ciblées doivent favoriser l’autonomisation économique et l’accès aux postes de décision, en tenant compte des inégalités structurelles. Juridiquement, il convient d’adapter et renforcer le cadre légal en requalifiant certaines infractions, en protégeant les droits sexuels et reproductifs et en garantissant un accès équitable à la justice ».
Associations présentées lors des éditions précédentes de la journée des droits femmes.
Fondation des femmes.

Si vous deviez présenter votre association en quelques lignes ?
« La Fondation des Femmes est la structure de référence en France sur les violences faites aux femmes et pour l’égalité femmes-hommes. Nous apportons un soutien financier, matériel et juridique aux associations de défense des droits des femmes avec les dons que nous collectons. Nous contribuons également à faire exister les enjeux d’égalité entre les femmes hommes dans le débat public avec nos rapports d’expertises et notre plaidoyer. »
Sur un plan juridique, quelles doivent être les avancées prioritaires des droits des femmes en 2022 ?
« A la Fondation des Femmes nous portons avec les associations, une Plan d’urgence pour l’Egalité. Ce sont 10 mesures que les candidat.e.s s’engagent à mettre en place dans les 100 premiers jours de leur quinquennat. Parmi elles, un "big bang" institutionnel avec la création de tribunaux spécialisés dans les violences faites aux femmes sur le modèle espagnol. Mais également un travail d’inventaire de l’ensemble des mécanismes juridiques qui accroissent la précarisation des femmes, notamment en couple. On peut citer par exemple les pensions de réversions qui sont conditionnées au fait que les femmes ne se remarient pas, ou encore la fiscalité des pensions alimentaires. »
Et les hommes, comment les associer à ce combat ?
« Les juristes et avocats qui lisent Village de la justice peuvent rejoindre les bénévoles de la Force juridique de la Fondation des Femmes, notre collectif de professionel.le.s du droit au services des associations de défense des droits des femmes. Ils peuvent aussi bien sûr devenir donateurs de la Fondation des Femmes et soutenir ainsi les associations qui agissent sur le terrain auprès des femmes. »
"Choisir la cause des femmes".

Si vous deviez présenter votre association en quelques lignes ?
« "Choisir la cause des femmes" a été fondée par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi en juin 1971, en plein débat pour le droit à l’avortement, que Gisèle Halimi a défendu aux côtés de Marie-Claire Chevallier (récemment décédée) dans le cadre du procès historique dit de Bobigny, qui a véritablement changé le cours de l’histoire des femmes en France.
L’association a ainsi vocation à promouvoir les droits des femmes, de toutes les femmes, principalement par la voie juridique et par le lobbying politique, l’une n’allant pas sans l’autre ».
Sur un plan juridique, que veut dire "choisir la cause des femmes" en 2022 ?
« Au-delà de la transmission mémorielle des luttes de Gisèle Halimi, l’association travaille activement sur ce que sont les enjeux actuels du féminisme, lesquels, au fond, demeurent dans la droite ligne des combats passés, pas complètement gagnés contrairement à ce que l’on imagine.
Les chantiers principaux de l’association, sont en particulier :
- Le consentement, dont on mesure, devant le désarroi des victimes d’agressions sexuelles lorsqu’elles parviennent à trouver le courage de porter plainte, à quel point la loi en vigueur est inadaptée, insuffisante ; une définition positive et une approche globale du consentement s’imposent.
- L’effectivité et la gratuité du droit à l’avortement, dont on comprend bien que l’allongement du délai légal est, finalement, une forme de palliatif à l’incapacité de la France de permettre aux femmes portant une grossesse non désirée d’y mettre un terme aussi rapidement qu’elles le souhaiteraient et qui les contraint – pour celles qui en ont les moyens – de partir à l’étranger.
- Et toujours, le projet de la Clause de l’Européenne la plus favorisée, mécanisme juridique destiné à instaurer l’harmonisation par le haut des droits des femmes de l’Union européenne. »
Le bureau est 100% féminin : est-ce un choix ? Plus largement, comment associer les hommes dans le combat qui est le vôtre ?
« L’histoire de "Choisir la cause des femmes" est née de la mixité puisque parmi les fondateurs, elle comptait aussi Jacques Monod, Prix Nobel de médecine, et Jean Rostand, académicien, même si les statuts d’origine de l’association prévoyaient que les Secrétaires nationales doivent être des femmes. Nous avons voulu respecter le choix initial des fondateurs.
Il n’en demeure pas moins que, de la même manière que Gisèle Halimi affirmait que le combat pour l’égalité des droits entre femmes et hommes doit se faire avec les hommes, ils sont toujours étroitement associés à nos actions, à nos webinaires, à nos conférences, dès lors que nous avons, parmi eux, des alliés des positions que nous défendons. »