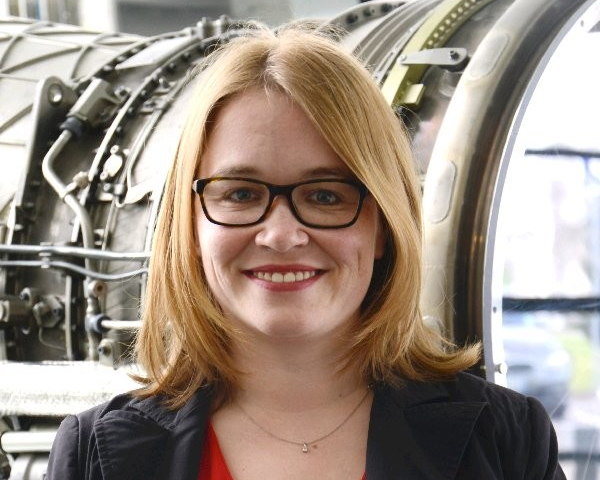Au sein de l’Union Européenne, le règlement 1215/2012 dit « Bruxelles I Bis » s’applique pour gérer les conflits de juridiction dès que le défendeur est situé sur le territoire de l’Union Européenne. Néanmoins, le considérant (14) précise que pour protéger les travailleurs, celui-ci peut s’appliquer sans considération du domicile du défendeur. Ainsi, si le salarié est domicilié sur le territoire de l’Union Européenne, alors, le règlement Bruxelles I Bis s’applique, même si l’employeur est localisé en dehors du territoire de l’Union Européenne.
A. Juridiction où attraire le salarié en télétravail international : source de risque pour l’employeur !
L’article 22 du règlement 1215/2012 est clair : le salarié ne peut être attrait que devant les juridictions de l’Etat où il a son domicile. Cela permet, en effet, au salarié d’être attrait devant une juridiction qu’il connaît et, probablement, qui opère dans une langue qu’il maîtrise. Avec le développement du télétravail, cette disposition n’est pas sans risque pour l’employeur : un élément d’extranéité peut apparaître.
Imaginons qu’un travailleur a son domicile dans l’Etat A et travaille pour un employeur domicilié dans le même Etat. Grâce à la flexibilité offerte par le télétravail - qu’il peut exercer à 100% ou une partie significative de son temps - le salarié décide de déménager dans l’Etat B. Dans ce cas, l’employeur est obligé d’attraire le travailleur devant les juridictions de l’Etat B, et ce, malgré le fait que la relation ait commencé dans l’Etat A. La décision du salarié de déménager a donc des conséquences pour son employeur puisqu’il est obligé de changer de juridiction. Pour une TPE ou une ETI, cela peut être source de risques juridiques et financiers : la connaissance des juridictions de l’État B, potentiellement dans une langue différente de celle de l’État A, est probablement inconnue. Or l’employeur ne peut pas contraindre son salarié à demander son accord avant de déménager sous peine de faire entrave à une de ses libertés fondamentales, celle du respect à sa vie privée [1]. Des conflits, liés au déménagement de travailleurs suite à une organisation du travail comprenant du télétravail, commencent donc à apparaître.
Ainsi, la Cour d’appel de Versailles a récemment jugé une affaire intéressante sur ce sujet [2]. Un salarié avait été embauché en 2015 dans une société spécialisée dans les réparations d’ordinateurs et équipements informatiques située en région parisienne. Il a déménagé en 2018 en Bretagne suite à la naissance de ses jumeaux et avait repris son activité en télétravail. En 2019, son employeur lui a demandé d’établir son domicile en région parisienne afin de limiter les risques, pour sa santé, inhérents aux longs temps de trajet. Le salarié a refusé et a été licencié pour faute. La cause réelle et sérieuse du licenciement a été retenue tant par le Conseil des Prud’hommes que par la Cour d’appel de Versailles car :
« aucune atteinte disproportionnée au libre choix du domicile personnel et familial au titre du droit au respect du domicile, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, n’apparaît caractérisée compte tenu de l’obligation essentielle de préservation de la santé et de la sécurité du salarié » [3].
Aussi, la décision réalise un équilibre très délicat entre la liberté d’installation du salarié et la préservation de la santé de celui-ci par l’employeur. Ces derniers pourraient être tentés de licencier tous les salariés qui s’installent trop loin de leur établissement de rattachement, notamment pour se protéger de juridictions inconnues. De nouvelles décisions - tant par la Cour de cassation que par la Cour de justice de l’Union Européenne, voire par la Cour européenne des droits de l’Homme - devront alors confirmer ou infirmer le choix retenu par la Cour d’appel de Versailles.
En l’état actuel des choses, le déménagement à l’étranger d’un salarié qui télétravaille fait peser sur l’employeur un risque lié à la juridiction saisie [4].
B. Juridiction où attraire l’employeur dont le salarié télétravaille en international : attention au lieu d’exécution habituel du travail.
L’article 21 du règlement 1215/2012 explique devant quelles juridictions un employeur peut être attrait. Le salarié a plusieurs options à son choix.
La première, la plus simple et prévue au a) de l’article, est d’attraire l’employeur devant les juridictions de l’Etat membre où se situe le domicile de celui-ci. Cette solution semble relativement aisée, car cela peut ou doit correspondre à la domiciliation de l’établissement qui a recruté le salarié. Le fait que le salarié soit en télétravail ou non n’a donc pas d’influence sur ce choix.
Mais, au titre du b) de l’article 21, il est possible également pour le salarié d’attraire son employeur devant :
« i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur ».
La logique est de simplifier la vie du salarié en lui proposant des juridictions qui lui sont proches.
La Cour de justice de l’Union Européenne a été amenée à préciser la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » dans le cadre de deux affaires jointes intéressantes [5] concernant du personnel de compagnie aérienne. Comme un télétravailleur qui exercerait son activité dans deux États, les membres de compagnies aérienne, notamment les équipages, travaillent dans de multiples pays et peuvent être une source d’inspiration pour l’interprétation de la notion dans le cadre du télétravail.
Dans ces affaires, la cour développe un raisonnement en plusieurs étapes. Le point 59 précise :
« Ainsi, dans de pareilles circonstances, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » consacrée à l’article 19, point 2, sous a), du règlement Bruxelles I doit être interprétée comme visant le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s’acquitte de fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur ».
Tout d’abord, la cour doit déterminer dans quel lieu le travailleur réalise l’essentiel de ses obligations. D’ailleurs, la cour a, à plusieurs reprises, précisé que l’interprétation du lieu d’accomplissement habituel doit se faire de manière large [6].
Ainsi, dans le cadre d’un télétravailleur, si celui-ci effectue son télétravail à 100% ou une partie essentielle de son temps, alors le lieu habituel d’accomplissement du travail sera celui où il télétravaille, donc dans l’État où il effectue son télétravail (sous réserve d’une volonté claire des parties, voir infra).
Dans le cas où le juge ne parvient pas à déterminer un tel lieu car le travailleur travaille dans plusieurs Etats, alors le juge doit « identifier le lieu à partir duquel ce travailleur s’acquittait principalement de ses obligations vis-à-vis de son employeur » [7].
Enfin, la cour propose, au point 61, une méthode dite « indiciaire » : « il ressort également de la jurisprudence de la cour que, pour déterminer concrètement ce lieu, il appartient à la juridiction nationale de se référer à un faisceau d’indices ».
Aussi, en cas de télétravail international avec une répartition du travail du salarié dans deux ou plusieurs Etats, le juge devra choisir les indices lui permettant d’établir où se trouve le lieu d’exécution habituel du télétravail. S’il est certain que le pourcentage de temps passé en télétravail sera retenu, d’autres critères devront être pris en compte par le juge comme le pays dans lequel est versé le salaire, le pays où se trouve l’établissement de rattachement, l’adresse de l’employeur sur la feuille de paie, etc.
Seule une appréciation souveraine des juges aux faits de l’espèce pourra être appliquée. Cela est donc source d’incertitude pour le télétravailleur et son employeur.
Afin de limiter les risques d’abus, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé dès 2002 dans l’arrêt Weber que seule la volonté claire des parties pouvait changer le lieu d’exécution habituel du travail : « Ainsi, la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de manière durable en un lieu différent, dès lors que, selon la volonté claire des parties, ce dernier est destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel au sens de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles » [8].
Suite à cette jurisprudence, plusieurs juridictions en Europe ont été amenée à vérifier la volonté des parties à modifier le lieu de travail habituel [9].
Ainsi, les parties ont intérêt à avoir une clause contractuelle claire et limpide précisant où le salarié effectue son activité de manière habituelle : cela fait partie des indices retenus par les juges pour déterminer la volonté des parties. En cas de télétravail international, une telle clause devient primordiale en cas de conflits.
C. Les clauses attributives de juridiction : une fausse bonne idée en matière de télétravail international.
Si, devant la généralisation du télétravail et le risque de voir des salariés déménager à l’étranger, les employeurs peuvent être tentés de proposer des clauses attributives de juridiction à leurs salariés, cela n’est, en pratique, pas possible ou recommandé.
En effet, l’article 23 du règlement 1215/2012 précise que :
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 1) postérieures à la naissance du différend ; ou 2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ».
La Cour de cassation interprète cet article de manière stricte en considérant que lorsque la clause est antérieure au litige, elle n’est pas opposable au salarié [10].
Par ailleurs, sur le second point, la Cour de justice de l’Union Européenne a été amenée à préciser que si la clause attributive de compétence est antérieure au litige, elle ne peut exclure les juridictions que le travailleur aurait le droit de saisir : elle ne peut que lui ouvrir des possibilités [11] et donc lui permettre de choisir parmi plusieurs juridictions.
Cette solution de clause attributive de juridiction est donc à manier avec prudence et ne semble guère apporter de sécurité juridique à l’employeur qui reste tenu d’attraire son salarié devant les juridictions du pays de son domicile.
Pour un télétravailleur, cela peut, néanmoins, être intéressant d’avoir une telle clause si celle-ci est bien rédigée conformément au règlement : elle peut lui offrir davantage de choix de juridictions compétentes.