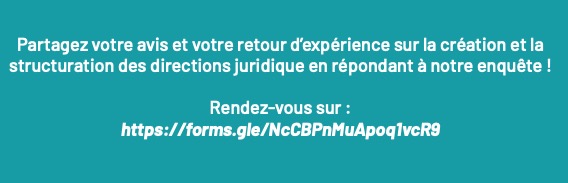Cet article est extrait du numéro 94 du Journal du Management Juridique sur les thèmes principaux "Transformation digitale, Legal Privilege, dossier "Risques"...
Partagez votre avis et votre retour d’expérience sur la création et la structuration des directions juridique en répondant à notre enquête !
Rendez-vous sur : https://forms.gle/NcCBPnMuApoq1vcR9 .
Au sommaire de cet article...
- I. Pourquoi créer une direction juridique interne ?
- II. Quand constituer une direction juridique ?
- III. Comment analyser les besoins juridiques ?
- IV. Comment définir les objectifs et les rôles du département juridique ?
- V. Comment recruter et composer l’équipe juridique ?
- VI. Comment structurer le département juridique ?
- VII. Quel positionnement et quel rattachement du département juridique ?
- VIII. Comment tenir compte de la dimension internationale de l’activité de l’entreprise ?
- IX. Comment promouvoir la culture juridique dans l’entreprise ?
- X. Quels défis et transformations à venir ?
- Synthèse
I. Pourquoi créer une direction juridique interne ?
La création d’une direction juridique interne permet à l’entreprise d’avoir un contrôle direct sur ses activités juridiques, d’assurer une meilleure intégration avec les autres départements et de développer une expertise juridique spécifique à ses besoins.
Elle permet également :
• une meilleure intégration de fonction juridique dans la stratégie globale de l’entreprise ;
• une plus grande réactivité problématiques juridiques ;
• une maîtrise des coûts à long terme ; • et une gestion plus efficace des risques.
II. Quand constituer une direction juridique ?
Existe-t-il un bon moment pour créer une direction juridique en tant que
telle ? À première vue, rien n’est certain en la matière et, finalement, tout dépend du besoin. Ce dernier varie en fonction de plusieurs facteurs. Les premiers retours à notre sondage révèlent, de manière assez logique, quatre paramètres :
• une réponse de principe : dès le lancement de l’activité ; •une approche économique : dès que les coûts d’externalisation deviennent trop importants ;
• une analyse pragmatique : lorsque la complexification des sujets nécessite différentes expertises ;
• une logique de croissance : le passage d’une PME à une ETI serait un moment-clé pour la création d’une direction juridique.
III. Comment analyser les besoins juridiques ?
Avant de créer un département juridique, il faut se poser la question suivante : quels sont les chantiers stratégiques à prioriser ? Il est en effet essentiel de mener une analyse approfondie des besoins juridiques de l’entreprise. Cela implique d’identifier les domaines juridiques pertinents, tels que les contrats, la propriété intellectuelle, la conformité réglementaire, les litiges et les affaires internationales.
Entre la définition d’une politique contractuelle, le déploiement de chantiers de mise en conformité réglementaire, le suivi des comités de pilotage de grands projets complexes, l’identification des risques juridico- financiers majeurs de deals stratégiques, ou encore la formation des dirigeants et opérationnels sur les enjeux juridiques liés à leurs activités. En comprenant les défis et les risques juridiques spécifiques auxquels l’entreprise est confrontée, il est alors possible de déterminer les compétences et les ressources nécessaires pour répondre à ces besoins.
Cette analyse des besoins juridiques peut être effectuée par le biais d’entretiens avec les parties prenantes internes, l’examen des éventuels contrats existants, l’évaluation des risques potentiels et la prise
en compte des exigences légales et réglementaires applicables. Elle permet d’identifier les domaines où une couverture juridique interne est nécessaire et de définir les priorités en termes de gestion des risques juridiques.
IV. Comment définir les objectifs et les rôles du département juridique ?
Une fois les besoins juridiques identifiés, il est important de définir clairement les objectifs et les rôles du département juridique. Cette étape permet de déterminer si le département sera axé principalement sur le conseil juridique stratégique, la gestion des risques, la conformité réglementaire ou une combinaison de ces domaines.
La définition des objectifs du département juridique doit être alignée sur les objectifs stratégiques de l’entreprise : il peut s’agir de soutenir la croissance de l’entreprise, de minimiser les risques juridiques, de favoriser l’innovation ou d’améliorer la conformité aux lois et réglementations. En clarifiant les responsabilités et les attentes, il devient plus facile de recruter les bons talents, de dimensionner et structurer l’équipe juridique en conséquence.
Il est bien certain que chaque secteur d’activité présente des spécificités et des défis juridiques qui lui sont propres. L’industrie, les services, la finance, entre autres, nécessitent une adaptation de la direction juridique aux exigences réglementaires spécifiques. Des stratégies d’adaptation doivent être mises en place pour répondre aux enjeux juridiques particuliers de chaque secteur. De même, il est clair que les grandes entreprises et les PME adoptent des approches différentes en matière de gestion juridique en raison de leurs ressources et de leur structure organisationnelle. Les grandes entreprises disposent généralement de départements juridiques plus importants, couvrant une multitude de domaines juridiques, tandis que les PME doivent faire preuve de créativité et d’efficacité pour développer une direction juridique malgré des ressources limitées.
V. Comment recruter et composer l’équipe juridique ?
Le recrutement et la composition de l’équipe juridique sont des étapes cruciales dans la création d’un département juridique efficace. Comment recruter et dimensionner l’équipe juridique adéquate ? Comment estimer et gérer le budget alloué au service ? Si les questions à se poser sont simples, les réponses à y apporter ne le sont pas nécessairement !
L’équipe juridique idéale peut comprendre des juristes spécialisés dans différents domaines juridiques, tels que le droit des affaires, la propriété intellectuelle et la conformité réglementaire. Ici, il est important de définir les profils de compétences nécessaires, en tenant compte des spécialités juridiques requises, des niveaux d’expérience et des compétences complémentaires pour garantir une couverture complète des besoins juridiques de l’entreprise.
La diversité des compétences au sein de l’équipe juridique permet de couvrir un large éventail de besoins juridiques et de favoriser la collaboration et le partage des connaissances. Il est également important de développer un plan de formation et de développement professionnel continu pour garantir que l’équipe reste à jour sur les dernières évolutions juridiques.
VI. Comment structurer le département juridique ?
La structuration du département juridique détermine la manière dont il sera organisé, qu’il s’agisse d’une structure centralisée, décentralisée ou hybride. Le choix de la structure dépend des caractéristiques et des objectifs de l’entreprise. Il est essentiel de choisir la structure qui correspond le mieux aux besoins et à la culture de l’entreprise.
Dans une structure hiérarchique (pyramidale), tous les juristes sont regroupés au sein d’un même département central, ce qui favorise une coordination et une cohérence plus étroites ainsi qu’une gestion centralisée des activités juridiques. Par exemple, une entreprise multinationale du secteur de la technologie peut choisir une structure centralisée pour assurer une cohérence et une harmonisation dans la gestion des contrats internationaux, des litiges transfrontaliers et des questions de propriété intellectuelle.
Dans une structure matricielle, les juristes sont répartis dans différents services opérationnels, ce qui permet une meilleure proximité et une connaissance approfondie des besoins spécifiques de chaque département, ce qui est particulièrement bénéfique dans les grandes entreprises avec des domaines d’activités diversifiés. Par exemple, une entreprise du secteur manufacturier peut opter pour une structure décentralisée pour faciliter la gestion des contrats d’approvisionnement, des questions de conformité et des litiges liés à chaque division opérationnelle.
Une structure hybride combine des éléments des deux approches pour tirer parti des avantages de chacune. Certaines fonctions juridiques peuvent être centralisées pour assurer une coordination et une cohérence, tandis que d’autres fonctions peuvent être décentralisées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque département. Une entreprise du secteur de la santé peut adopter une structure hybride en centralisant les questions de conformité réglementaire, mais en décentralisant la gestion des litiges médicaux à chaque établissement.
VII. Quel positionnement et quel rattachement du département juridique ?
Pour assurer une intégration harmonieuse du département juridique dans l’entreprise, il est essentiel d’orienter le pilotage du service juridique en alignement avec la stratégie globale de l’entreprise. En ce sens, le positionnement et le rattachement du département juridique au sein de l’entreprise sont des aspects cruciaux. Il importe donc de répondre à la question suivante : comment en faire un pôle stratégique créateur de valeurs pour l’organisation globale ?
Le département juridique peut être rattaché à la direction générale, au directeur financier, au secrétaire général ou à un autre département clé de l’entreprise. Le choix du positionnement dépend des objectifs stratégiques de l’entreprise et de la manière dont le département juridique interagit avec les autres départements. Le positionnement dépend de la volonté de la direction d’intégrer la fonction juridique dans les décisions stratégiques de l’entreprise.
En effet, un positionnement stratégique permet d’assurer une influence et une participation significatives dans la prise de décisions et la gestion des risques. Une proximité avec la direction permet une meilleure coordination et un alignement sur les objectifs organisationnels.
Notons également que lorsqu’il s’agit de décrire la place du droit dans la stratégie de leur entreprise, les premiers répondants à notre enquête ont utilisé des termes tels que "essentielle", "prépondérante", "transversale et stratégique", "clé" et "support". Ces retours soulignent l’importance du droit dans la prise de décision stratégique et la gestion des risques au sein des entreprises, et nous ne pouvons que nous en réjouir !
VIII. Comment tenir compte de la dimension internationale de l’activité de l’entreprise ?
Dans un contexte mondialisé, la dimension internationale est un aspect essentiel à prendre en compte lors de la création et de la structuration d’un département juridique. Les entreprises qui opèrent à l’échelle mondiale doivent tenir compte des différences juridiques, culturelles et réglementaires dans chaque pays où elles sont présentes. Mais lorsque les entités dont on a la charge s’étendent sur des dizaines de pays, comment prendre en compte toutes les spécificités locales ? La coordination entre les équipes juridiques locales et centrales sera ici essentielle pour garantir une approche cohérente et conforme aux exigences internationales.
Par exemple, une entreprise de commerce électronique qui se déploie dans différents pays devra tenir compte des réglementations relatives à la protection des données, à la confidentialité des consommateurs et aux contrats internationaux. Cela implique de comprendre les lois et pratiques juridiques des différents pays où l’entreprise opère, ainsi que les défis liés aux différences culturelles et aux systèmes juridiques divers.
IX. Comment promouvoir la culture juridique dans l’entreprise ?
La création et la structuration d’une direction juridique peut également avoir pour objectif de promouvoir la culture juridique au sein de l’entreprise. Le but est de sécuriser juridiquement les pratiques des opérationnels au sein des autres directions métiers et, partant, de faciliter le travail des équipes juridiques. Promouvoir une culture juridique qui valorise l’éthique, la conformité et la responsabilité juridique contribue à renforcer la confiance et l’intégrité au sein de l’organisation.
Aussi la communication efficace du département juridique s’avère-t-elle être un élément-clé pour assurer le bon fonctionnement du département juridique. Il est donc essentiel d’établir des canaux de communication clairs avec les autres départements de l’entreprise, afin de fournir des conseils juridiques en temps opportun et de faciliter la collaboration.
Il s’agit donc, aussi, de développer des relations étroites avec les autres départements, de fournir des conseils juridiques clairs et pratiques et de sensibiliser les dirigeants et les employés aux enjeux juridiques liés à leurs activités. Il peut être utile de mettre en place des programmes de formation internes sur les aspects juridiques pertinents.
X. Quels défis et transformations à venir ?
Les entreprises devront relever des défis juridiques majeurs dans les années à venir, tels que l’adaptation aux réglementations sectorielles, aux multiples facettes du droit et aux évolutions jurisprudentielles, à la gestion des risques numériques, à la protection des données et la cybersécurité, ainsi qu’à la simplification des processus et à la crédibilité accrue auprès des opérationnels.
La complexité croissante des domaines juridiques et l’évolution des jurisprudences nécessiteront une expertise spécialisée et une veille constante. Les équipes juridiques devront donc se transformer pour répondre aux défis futurs.
Selon les premiers résultats de l’enquête menée, la digitalisation, la numérisation des dossiers, la dématérialisation et l’utilisation des legaltech seront des éléments-clés de cette transformation. Les équipes devront également intégrer les critères RSE et développer une expertise dans le domaine de la technologie et des transformations numériques.
Synthèse
La création et la structuration d’un département juridique en entreprise sont des démarches complexes qui nécessitent une analyse approfondie, une vision stratégique et une coordination efficace.
En mettant en place un département juridique solide et bien structuré, les entreprises peuvent bénéficier d’un soutien juridique stratégique, d’une gestion proactive des risques et d’une conformité renforcée. Il est essentiel de considérer les différents aspects, tels que l’analyse des besoins juridiques, la définition des objectifs, le recrutement, la structuration, le positionnement, la dimension internationale, la communication et la culture juridique, pour garantir le succès et l’efficacité du département juridique et ainsi contribuer à la réussite globale de l’entreprise.
En investissant dans une fonction juridique interne forte, les entreprises sont mieux préparées à faire face aux défis juridiques et à saisir les opportunités dans un environnement commercial en évolution constante. La création d’un département juridique bien structuré contribue à l’efficacité opérationnelle, à la gestion des risques et à la protection des intérêts de l’entreprise, tout en favorisant une culture de conformité et d’intégrité.