1/ Un nouveau contexte et de nouvelles possibilités.
Dans le cadre de sa politique open data, l’État français [1] a mis à disposition de tous plus de 350 000 décisions de justice correspondant au contenu du site Légifrance [2]. Face à cette quantité de textes, les outils de recherche existants sont parfois inadaptés.
Parallèlement, la communauté technologique (universités, centre de recherche, petites et grandes sociétés) a fait évoluer de façon spectaculaire les algorithmes prédictifs dédiés à la compréhension du langage humain. L’état de l’art nous permet d’extraire des informations fiables et précises à partir de documents comme un humain le ferait.
Cette combinaison nouvelle, où données juridiques et algorithmes puissants sont disponibles, offre la possibilité de traiter massivement la jurisprudence en vue d’en extraire une vision synthétique et inédite.
Supralegem.fr applique ces algorithmes pour extraire entre autres la qualité du demandeur [3] et du défendeur, la nature du dispositif [4] ou le thème de la décision [5].
Pour cela, nous faisons lire de nombreux textes aux algorithmes puis nous leur posons plusieurs millions de questions, tous textes confondus. Lorsque la réponse est fausse, les algorithmes s’adaptent de manière à ce que cette erreur n’arrive plus (ou qu’elle arrive moins souvent). La procédure est répétée une centaine de fois. Un serveur spécialement équipé, dont la puissance brute équivaut approximativement à une cinquantaine d’ordinateurs classiques, met entre 5 et 6 jours pour tout exécuter. Enfin, les résultats sont mis à disposition pour être interrogés par les juristes en quelques secondes.
La précision de nos résultats se situe entre 90% et 99% en fonction du champ extrait. C’est à notre connaissance la première fois que des algorithmes ayant une forme de compréhension du sens des mots et des phrases sont appliqués à la jurisprudence francaise.
La suite de la méthodologie est simple. Les décisions qui traitent d’une question de droit sont sélectionnées puis agrégées afin de calculer des statistiques par juge ou par cour. Cela permet de comparer, par exemple, le taux de rejet entre plusieurs juges.
Cette approche est véritablement innovante dans la mesure où les tendances sont dégagées à partir de données objectives et vérifiables et non des points de vue subjectifs et des rumeurs. C’est un vrai changement de paradigme.
2/ Le cas des Obligations de Quitter le Territoire Français (OQTF).
Une possible application de cette démarche concerne les demandes d’annulation d’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF ci-après). Il s’agit de la mesure d’éloignement dont peuvent être frappés les étrangers en situation irrégulière ayant pour conséquence la reconduite à la frontière. Lorsque la demande est rejetée, cela signifie que l’étranger doit quitter le territoire français. Ce contentieux est le plus important en quantité dans les juridictions administratives [6].
La partialité de certains juges en matière d’OQTF est un sujet sensible plusieurs fois dénoncé par différents acteurs du système juridique comme l’assistant de justice @bismatoj sur Twitter en 2015 [7].
L’assistant de justice est un jeune juriste qui assiste un magistrat en rédigeant des projets de décision. L’assistant de justice se voit confier des dossiers par le magistrat rapporteur, et est lui-même chargé d’analyser les échanges d’écritures et les pièces produites devant la juridiction. Dès lors, il se forge une conviction juridique à l’instar du magistrat, et propose un sens du jugement que le magistrat administratif est libre de suivre. Ce sont les magistrats qui ont le dernier mot, mais sur les cas simples, ils reprendront le plus souvent le travail de l’assistant.
Selon cet assistant de justice, certains présidents de chambre demandent, pour les dossiers de demande d’annulation d’OQTF, à ce qu’un projet de jugement de rejet de la demande d’annulation soit systématiquement rédigé avant même d’avoir étudié le dossier au fond et en maîtriser le contexte juridique et factuel. Un jugement de rejet est proposé par l’assistant de justice, y compris lorsqu’il est contraire à sa conviction et que le dossier semble solide et à l’avantage de l’étranger. Pour ces juges, le rejet serait effectivement prononcé dans 90% des cas.
Les algorithmes de Supralegem.fr nous permettent de vérifier cette affirmation en sélectionnant les décisions qui concernent les demandes d’annulation d’OQTF et en calculant les taux de rejet par année, par juge et par cour.
Nous sélectionnons les décisions dont le thème est le droit des étrangers qui contiennent les expressions “quitter le territoire”, “étranger” et “asile”. Nous ne gardons que les affaires où le requérant est un particulier et où le défendeur est l’administration.
Nous pouvons extraire les taux de rejet les plus bas et les plus hauts parmi les juges qui ont émis le plus de décisions. Par “juge”, il faut comprendre président de la chambre qui a statué dans la suite de cet article.
| Chambre présidée par... | Cour adm. d’appel | % 2012 | % 2013 | % 2014 | % 2015 | Nb. décisions [12-15] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrive | Marseille | 78% | 47% | 43% | 60% | 455 |
| Cherrier | Marseille | NA | NA | 67% | 63% | 233 |
| Krulic | Paris | NA | NA | 60% | 73% | 199 |
| Tandonnet Turot | Paris | 90% | 97% | 98% | 100%* | 228 |
| Pellissier | Nancy | NA | 93% | 92% | 96% | 302 |
| Mortelecq | Douai | 92% | 92% | 92% | 0%* | 419 |
* : ce taux ne repose pas sur un nombre significatif de décisions
Le taux de rejet moyen pour ces jurisprudences, tous juges confondus, oscille entre 78% et 81% [8] sur la période 2012-2015 .
L’écart entre les taux extrêmes est frappant : plus de 40 points ! Les taux de rejet par juge sont plutôt constants dans le temps, indiquant des tendances de fond.
La lecture des décisions en question montre qu’un même juge peut traiter des dossiers relatifs à des étrangers issus de différentes zones géographiques (pays ou continents), mais rejeter presque toutes les demandes d’annulation.
Seule une lecture attentive des pièces du dossier nous permettrait de trancher le bien-fondé de chaque décision, ce qui est impossible puisque ces pièces ne sont pas diffusées. Cependant, nous disposons de statistiques très significatives qui indiquent qu’une partialité apparente [9] existe chez certains juges administratifs d’appel.
Pour contrôler la cohérence des résultats présentés ci-dessus, nous pouvons mener l’expérience inverse en calculant le taux de rejet lorsque le requêrant est l’administration et le défendeur est un particulier (les autres critères de sélection des décisions sont identiques à ceux utilisés précédemment).
| Chambre présidée par... | Cour adm. d’appel | % 2012 | % 2013 | % 2014 | % 2015 | Nb. décisions [12-15] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrive | Marseille | 16%* | 64% | 55% | 89%* | 37 |
| Cherrier | Marseille | NA | NA | 71% | 12%* | 29 |
| Krulic | Paris | NA | NA | 78% | 65% | 61 |
| Tandonnet Turot | Paris | 0% | 6% | 5% | NA | 121 |
| Pellissier | Nancy | NA | 0% | 50%* | 60%* | 16 |
| Mortelecq | Douai | 50%* | 22% | 23% | NA | 80 |
* : ce taux ne repose pas sur un nombre significatif de décisions
Nous constatons que les juges sévères avec les particuliers sont les plus conciliants avec l’administration et inversement. Il semble donc bien y avoir en matière d’OQTF des juges soumis à l’administration et d’autres davantage rebelles.
Quid du rôle de l’avocat face à un juge qui a déjà tranché le dossier avant de l’avoir entendu ?
3/ L’extension à d’autres questions de droit
Le projet repose sur un constat simple selon lequel le juge reste un homme. Dès lors, la subjectivité est possible.
Supralegem.fr reprend [10] la jurisprudence administrative figurant sur Légifrance et propose des outils de recherche et d’analyse basés sur ces traitements.
Le moteur de recherche permet de créer des statistiques pour chaque juge administratif d’appel afin de dégager des tendances invisibles autrement. Ainsi, l’utilisateur connaît la position doctrinale de son juge sur sa question. Ce savoir peut réduire l’aléa propre à la pratique du métier d’avocat en matière contentieuse.
Le site facilite également les recherches de jurisprudences en utilisant différents filtres basés sur les données extraites, tel que la nature du dispositif, la nature du demandeur et du défendeur ou la catégorie de la décision.
En droit administratif, l’administration gagne plus souvent qu’elle ne perd. Plus de 70% des requêtes présentées par une partie privée font l’objet d’un rejet. Écarter 70% des requêtes permet souvent de ne garder que ce qui intéresse le juriste, comme par exemple les cas où la demande en annulation d’un acte administratif a été prononcée, où la décharge d’impôts du contribuable est accordée, etc.
Très concrètement, un avocat en droit des étrangers sera sûrement intéressé de connaître les décisions où un étranger du même pays que son client a gagné contre l’administration dans un dossier d’OQTF. En utilisant les filtres, l’avocat ne verra que les décisions d’annulation d’une OQTF où le demandeur est un particulier, le défendeur est une administration et où la décision contient dans son texte l’expression “quitter le territoire” (expression qu’on retrouve dans toutes les décisions d’OQTF) et le nom du pays de son client. Ainsi, l’avocat peut éviter de lire des milliers de décisions inutiles pour son affaire.
Il peut aussi en quelques clics ne voir que les décisions où l’administration est requérante et voit sa demande rejetée. Comme dans notre analyse sur les OQTF.
À notre connaissance, ce projet est une première en France, tant par le nombre de décisions sur lesquelles les algorithmes ont été appliqués que la sophistication des algorithmes utilisés et de la qualité des résultats trouvés. [11]


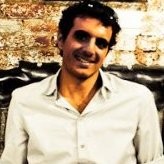

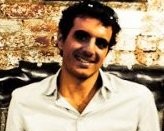


































Discussions en cours :
Et en matière fiscal, le % de procès perdus par les contribuables ?
Il nous semble que cette question doit être traitée qu’impôt par impôt.
Nous vous invitons à vous rendre sur notre site http://www.supralegem.fr pour tester les taux en question.
Votre travail pourra certainement être affiné et complété, mais à mon avis il a le mérite d’objectiver un constat que le praticien que je suis fait au quotidien : certaines formations de jugement ont des approches significativement différentes en matière d’oqtf. Cela ne relève d’ailleurs pas seulement du président mais aussi des assesseurs. Cela s’explique parce que c’est une matière où l’a priori plus ou moins favorable aux requérants ou à l’administration est nettement plus marqué que dans d’autres et que les marges d’appréciation, notamment sur la vie privée et familiale, sont bien plus importantes que dans d’autres contentieux.
La démarche est intéressante, sauf que la méthodologie est hélas d’un amateurisme regrettable.
Toutes les décisions des CAA en matière d’OQTF ne sont pas versées sur Legifrance, mais seulement une sélection des décisions collégiales.
Or la façon de constituer cette sélection est erratique, certains versent tout, d’autres presque rien. Donc çà n’a pas de sens de faire des mesures à partir de Legifrance, les échantillons n’étant ni complets ni représentatifs.
En outre, il est possible de statuer ordonnances, non seulement sur le fondement procédural du droit commun (R. 222-1 CJA) mais également lorsque l’appel est manifestement insusceptible d’entraîner l’infirmation de la décision (R. 776-9 CJA). Or les ordonnances ne figurent pas sur Legifrance.
Si le président filtre de façon importante par ordonnance, reste à la fin un ensemble plus réduit d’affaires jugées en collégiale où les annulations prennent, selon votre méthodologie, une part plus importante. Ce serait selon vous signe d’un plus grand libéralisme : or c’est un contresens.
Autre point, les dossiers arrivant devant chaque juridiction ne sont pas comparables entre eux. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas les mêmes pratiques que celui de Gironde ou de Côte-d’Or. Il n’y a donc aucune raison que le taux d’annulation soit le même à Marseille, Versailles, Nancy ou Paris. Tout au plus pourriez-vous comparer les présidents au sein d’une même juridiction, ce que malheureusement vous ne faites pas.
Enfin, ce n’est pas parce qu’un juge dévie d’une moyenne qu’il est partial contrairement à ce que vous affirmez. L’influence de la personnalité des juges sur les décisions rendues n’est pas une question de partialité. Une telle influence n’est nullement à démontrer (de nombreuses études US s’en s’ont déjà chargé), mais à quantifier, ce que compte tenu d’une méthodologie insuffisamment rigoureuse votre étude n’arrive pas à faire.
Peut-être serait-il utile que vous la repreniez en corrigeant ces biais aussi évidents que dirimants.
Je vous remercie pour votre commentaire.
Je vais essayer de répondre point par point à vos remarques.
Tout d’abord, sur l’alimentation de la base alimentant le stock Jade, depuis le 1er janvier 2015, il est demandé aux CAA de remettre 100% des décisions collégiales (https://twitter.com/supralegem/status/713415667052097536).
Des chiffres publiés par le Conseil d’État dans son rapport d’activité publié en 2015, Légifrance (stock Jade) contient d’un tiers à deux tiers des arrêts rendus par les Cours administratives d’appel.
Contrairement à votre sentiment sur le caractère erratique de l’alimentation de la base Jade, les données montrent qu’il n’y a pas de Cour administratives d’appel qui ne verse “presque rien” dans le stock sur la pèriode étudiée (vérifiable simplement sur notre site).
Les volumes, les proportions et la grandeur des écarts remontés paraissent largement suffisants pour procéder à des statistiques qui soient significatives. Pour plus d’information sur le fonctionnement des statistiques je vous invite à lire cet excellent article : https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_significance Vous y verrez en quoi le caractère non complet du stock de décisions n’est en rien un problème : travailler sur un échantillon est en fait l’essence même des statistiques !
Concernant les conséquences de l’article R.222-1 du CJA, ce dernier permet par voie d’ordonnance entre autres de rejeter les requêtes quand il n’y a “pas lieu” de statuer dessus ou lorsqu’elles sont “manifestement irrecevables”. Les conditions d’ouverture sont listées limitativement car cette disposition est grave dans ses conséquences puisqu’elle aboutit à ne pas étudier en profondeur la requête. Elle permet évidemment au magistrat de ne pas passer du temps sur des requêtes qui ne le méritent pas. L’article R.776-9 du CJA renvoie vers R.222-1 du CJA.
Vous suggérez que cette disposition est à même d’expliquer des écarts de 20 à 30 points entre deux magistrats. Cela implique donc, selon vous, que certains magistrats ont une lecture très large des conditions d’ouverture de cette disposition. C’est une critique connue : certains magistrats abuseraient de cet article en l’utilisant pour des requêtes qui ne sont pas “manifestement irrecevables”, en particulier en droit des étrangers. L’objectif serait de gagner du temps sur un contentieux de masse, les moyens de la justice étant en totale inadéquation avec ce qu’on exige d’elle, notamment en matière de célérité.
[SUITE DANS MESSAGE 2]
[SUITE MESSAGE 2/2]
Je pense que votre point est tout à fait pertinent, cette apparente partialité pourrait s’expliquer par un usage abusif de cet article, qui dégénérerait clairement en déni de justice. Cependant, les données à notre disposition nous empêchent de vérifier cette théorie et c’est pour cette raison que je me suis gardé de l’écrire. Comme dit précédemment, il s’agit ici de présenter des chiffres objectifs, nous laissons l’étude des causes de ces anomalies apparentes à d’autres.
Expliquer les variations en fonction des pratiques locales est intéressant mais inopérant.
Tout d’abord les grandeurs dont il est question rendent cette approche peu pertinente.
Par ailleurs, cela n’explique en rien la corrélation négative entre les taux de rejet lorsque le demandeur est un particulier ou lorsque c’est l’administration. Comment expliquer qu’une chambre puisse avoir un taux de rejet de 98% en 2014 (94 rejets, *une seule* annulation de jugement de première instance et un désistement) lorsque les requérants sont des personnes physiques et passer à 5% lorsque l’administration est en demande ? C’est bien entendu tout aussi vrai pour les autres juges cités. J’y vois, pour ma part, une validation assez nette de la démarche et de la méthodologie. Mais peut être avez-vous une explication qui m’échappe ?
Enfin, au sein d’une même Cour, de grandes disparités peuvent exister entre présidents de chambre. C’est particulièrement vrai à Paris et à Versailles. Dans le tableau, on le voit pour deux exemples concernant Paris. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à utiliser notre site Supra Legem.
Sur l’interprétation des causes des variations (la personnalité, etc.), comme dit précédemment, c’est hors du champ de ce que nous pouvons faire avec nos algorithmes. Nous assumons pleinement cette limitation.
Je note tout de même un point positif, vous trouvez la démarche intéressante. Je serai ravi d’échanger davantage avec vous par email ou de visu (sur Paris) sur la démarche, et pas nécessairement l’OQTF. Vous pouvez me contacter via le formulaire sur notre site (page A propos).
J’espère recevoir de vos nouvelles.
Cordialement,
Michaël
REPONSE A MICHAEL BENESTY Partie 1
Je vous indiquais que la proportion d’arrêts versés dans la base peut varier selon les chambres. Vous me répondez que les CAA versent chacune beaucoup d’arrêts, autrement dit à côté. Votre article s’appuie sur des taux par chambre (et non des valeurs absolues par CAA), donc ce qui compte au regard de votre article c’est bien la proportion d’arrêts versée par chambre, et non le volume d’arrêts versés par CAA.
Vous indiquez ensuite que c’est le propre des statistiques de travailler sur des échantillons. Certes, mais des statistiques valables ne peuvent être réalisées qu’à partir d’échantillons représentatifs, la représentativité de l’échantillon étant une question fondamentale en statistiques (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chantillon_%28statistiques%29). Or le problème est que vos échantillons ne sont pas représentatifs. Si une chambre rend 100 arrêts dont 10 annulations et 90 rejets et qu’elle en verse 50 dans la base de données dont les 10 annulations, votre système donne un taux facial de 20% d’annulation alors que le taux réel est de 10%.
Je ne comprends pas votre remarque sur les ordonnances ; vous semblez dire (mais pas clairement) que les cas d’ordonnances sont limitativement énumérés par l’article R. 222-1, qui porterait notamment sur les irrecevabilités (vous passez déjà sous silence le 7°). Or l’article R. 776-9 prévoit que « [le président de CAA] peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d’entraîner l’infirmation de la décision attaquée. », ce qui dépasse le seul cadre de l’article R. 222-1. Requêtes qui ne sont pas manifestement pas susceptibles d’entraîner l’infirmation de la décision attaquée = requêtes d’appel manifestement infondées.
Je ne comprends pas non plus votre remarque sur le fait que le recours différencié aux ordonnances révèlerait des "abus" ou des "dénis de justice". En présence d’une requête bel et bien manifestement infondée, le président de chambre a juridiquement le choix entre la trier par ordonnance ou la faire passer en formation collégiale. Le choix des uns de faire plus d’ordonnances que d’autres n’appelle aucun jugement de valeur mièvre.
Je me suis permis de manuellement vérifier un chiffre de votre tableau (et je ne le ferai qu’une fois, je n’ai pas que çà à faire), à savoir le taux de rejet en 2015 pour la première ligne (CAA Marseille, M. G.). Je compte 15 annulations, 41 rejets, 3 autres (2 annulations d’ordonnances avec renvoi au TA, 1 sursis à exécution). Le taux de rejet rapporté aux annulations est de 73,21% (41/56), et il est de 69,49% rapporté à l’ensemble des arrêts (41/59). Or vous donnez 60%.
Donc la seule chose qui est confirmée, c’est la marge d’erreur de vos chiffres de 10% (au moins).
REPONSE A MICKAEL BENESTY Partie 2
La remarque de votre article sur « L’écart entre les taux extrêmes est frappant : plus de 40 points ! » est stupide compte tenu des marges d’erreur de votre système : lorsqu’on compare un résultat ayant une marge d’erreur de 10% avec un autre résultat ayant une marge d’erreur de 10%, la marge d’erreur affectant la comparaison est de 20%. Donc la moitié de la différence entre les valeurs extrêmes s’explique par vos marges d’erreur.
A partir du moment où on parle d’échantillons non représentatifs, avec derrière des mécanismes non quantifiables qui influent sur les résultats, et une marge d’erreur de 10%, la seule explication qui vous échappe est que vos chiffres ne sont pas assez précis pour en tirer quelque conclusion que ce soit.
Enfin, votre remarque sur l’interprétation des causes des variations est particulièrement hypocrite. Il suffit de lire votre titre et le reste de l’article pour voir qu’au contraire votre interprétation est déjà toute trouvée .et porte sur l’absence d’impartialité de juges pris individuellement, idée reçue fort pauvre sur la justice administrative que vous essayez absolument de conforter en triturant des chiffres auxquels on ne peut en réalité rien faire dire de sérieux.
Cher Scif,
Je vous remercie d’avoir passé du temps à étudier notre projet.
Vos remarques sont toujours intéressantes même si je ne suis pas nécessairement d’accord.
Je ne vais pas avoir le temps cette semaine de répondre à chaque point.
Mais j’y procéderai certainement dans les semaines à venir.
En attendant, il y a tout de même une objection que vous faites à laquelle je dois répondre au plus vite.
Je ne veux pas que de fausses interprétations de nos résultats soient diffusées.
Il s’agit de la supposée erreur de calcul de 10 points.
Pour M. G de la CAA de Marseille, il y a 93 décisions d’OQTF en 2015.
Dans l’article je donne mes critères de sélection.
Grâce au site, vous pourrez reproduire cette sélection de votre côté.
Je viens de relire personnellement les 93 décisions, elles traitent toutes d’OQTF.
J’ai l’impression que vous utilisez d’autres critères, mais ce n’est pas très clair dans votre commentaire.
Vous dénombrez 41 rejets (est-ce une analyse manuelle ?).
Le site en rapporte 56 sur cette même période selon les critères que j’utilise.
Je viens de vérifier manuellement que chacune de ces décisions est bien un rejet de la demande de l’étranger.
Quoi qu’il en soit, le taux de 60% est le résultat du nombre de rejets divisé par le nombre de décisions, soit :
56/93 = 0.6
Votre calcul de rapport des rejets (de décisions) aux annulations (d’actes) n’a pas vraiment de sens, car votre dénominateur ignore un certain nombre de décisions.
De plus, ce n’est pas ce que nous avons calculé, il ne sert à rien de le comparer avec nos pourcentages.
J’ignore d’où sortent les nombres de votre second calcul, je ne peux donc pas le commenter.
Concernant vos additions de pourcentages d’erreur, j’ai bien peur que ce soit tout aussi faux.
On n’additionne pas des pourcentages d’erreur (au-delà du fait que les vôtres soient faux).
En statistique on calcule des intervalles de confiance (c’est un peu plus sophistiqué que l’addition).
Je trouve vraiment dommage que vous ayez passé du temps en pleine nuit (d’après l’heure à laquelle votre commentaire a été posté) sur ce genre de choses sans avoir pris la peine de me contacter au préalable alors que je vous l’ai proposé.
J’insiste, je suis tout à fait ouvert à la discussion.
Je n’ai pas de problème à entendre la critique et au besoin d’améliorer le site.
Donc je renouvelle par ce message mon offre de discussion (email ou, mieux je pense, de visu sur Paris).
Cordialement,
Michaël
Il est assez amusant que vous partiez sans recul du simple témoignage sur Twitter d’un assistant de justice en cour administrative d’appel pour en tirer de grandes généralités sur la justice administrative en général.
Ainsi et à vous lire, l’assistant de justice même inexpérimenté fait des propositions objectives et argumentées, alors que les magistrats ayant une longue carrière juridictionnelle font preuve de partialité en ne suivant pas leurs propositions.
Un peu de sérieux. La plupart des assistants de justice sortent tout juste de l’université et :
 sont en première expérience professionnelle, ils découvrent le monde du travail ;
sont en première expérience professionnelle, ils découvrent le monde du travail ;
 découvrent également l’organisation et le fonctionnement des juridictions administratives ;
découvrent également l’organisation et le fonctionnement des juridictions administratives ;
 découvrent enfin le fonctionnement concret du droit et de la jurisprudence.
découvrent enfin le fonctionnement concret du droit et de la jurisprudence.
Ce qui fait beaucoup d’un coup pour eux, et un nouvel assistant de justice n’a pas toujours une bonne compréhension de son environnement.
Si un président de chambre a donné consigne à un assistant de préparer des projets de rejet (ce qui ne préjuge pas de la décision finale, qui est collégiale contrairement à ce que votre étude sous-entend), ce peut être pour d’autres motifs qu’un problème de partialité, telles que par exemple :
 l’historique de l’assistant de justice concerné, si celui-ci a montré sa propension à préparer des propositions d’annulation injustifiées ;
l’historique de l’assistant de justice concerné, si celui-ci a montré sa propension à préparer des propositions d’annulation injustifiées ;
 ou encore en appel, le simple fait de considérer que la position des juges de première instance (3 magistrats cumulant une certaine expérience) est a priori plus justifiée que la position personnelle d’un assistant de justice inexpérimenté.
ou encore en appel, le simple fait de considérer que la position des juges de première instance (3 magistrats cumulant une certaine expérience) est a priori plus justifiée que la position personnelle d’un assistant de justice inexpérimenté.
Toutes choses vis-à-vis desquelles l’assistant de justice concerné n’a peut-être pas un recul suffisant pour comprendre, d’où des tweets offusqués.
Selon vous "La partialité de certains juges en matière d’OQTF est un sujet sensible plusieurs fois dénoncé par différents acteurs du système juridique".
Mais le fait qu’un cliché soit véhiculé par différents acteurs du système juridique, à savoir les avocats, ne veut pas dire qu’il est vrai, mais que ceux-ci ont intérêt à le croire et à le répéter : "si on a perdu cette affaire mon bon monsieur, c’est à cause du juge !"
Le thème de votre article, à savoir la prétendue "partialité" des juges administratifs, ne retranscrit hélas qu’un tissu de clichés à partir d’analyses déficientes, comme l’indique le précédent commentateur. Ce n’est pas intelligent de votre part d’en faire votre miel pour jeter des noms en pâture sur internet.
Cher Greg,
Vous basez toute votre critique sur le fait que nous sommes partis "du simple témoignage sur Twitter d’un assistant de justice".
Ce témoignage est une introduction au thème. Il n’a bien évidemment pas vocation à être représentatif des pratiques de toutes les juridictions administratives.
Le reste de l’article ne s’appuie pas dessus. Les chiffres présentés ont été calculés indépendamment de ce témoignage et semblent néanmoins le corroborer pour certains présidents de chambre.
Concernant le rôle de l’assistant de justice dans les juridictions, ils exécutement une certaine quantité de travail. Dans des juridictions dont les moyens ne sont pas toujours en adéquation avec le stock de contentieux à traiter, et où la pression sur les délais de traitement des dossiers est croissante, ils sont devenus un rouage important.
S’ils avaient une si mauvaise compréhension de leur "environnement" comme vous l’indiquez, dans l’intérêt des justiciables, j’espère bien qu’aucun magistrat ne s’appuierait sur ce qu’ils produisent !
Cordialement,
Michaël
Nous souhaitons effectuer un correctif. La première plateforme à proposer et exploiter des décisions de justice à des fins prédictives a été créée en octobre 2015 dans le domaine du droit social et pour particulièrement sur les problématiques de licenciement.
Nous sommes ravis de voir l’engouement qu’il y a eu depuis sur ce sujet.
Le droit fiscal doit bien entendu se doter d’un tel outil !
Tiphaine Lecoeur
Tyr-Legal
http://www.tyr-legal.fr/
Merci Tiphaine pour votre commentaire.
J’ignorais l’existence de votre site.
Je n’ai pas trouvé la description de votre méthodologie.
Pourriez-vous m’indiquer si elle est indiquée quelque part ?
J’ai l’impression que l’on parle de quantités de décisions/textes analysés très différentes.
Nous avons travaillé sur 350K décisions et nous en présentons 250K.
Les résultats sont directement accessibles sur notre site par tout utilisateur.
Par ailleurs le projet Supra Legem traite tout le droit public, pas uniquement le fiscal.
De ces constats préalables je ne suis pas certain que les échelles et les méthodes soient comparables.
Cordialement,
Michaël
Bonjour,
Il me paraît évident que des juges ne sauraient être complètement détachés de leur vision des choses, ils restent des êtres humains.
Mais quitte à dénoncer la partialité des juges, de par leur conscience, pourquoi ne pas aussi dénoncer cette même partialité vis à vis de la politique ?
Affirmer que les convictions d’un juge influencent ses décisions, sans parler de l’influence politique sur ces mêmes décisions, c’est de la désinformation. Effectivement, les pensées personnelles des juges sur la société retentissent bien moins dans les décisions que l’orientation gouvernementale ( et surtout Européenne, bien sûr. )
Peu importe les beaux articles sur l’indépendance de la justice, ce ne sont que de beaux articles, comme l’affirmation de la souveraineté de l’Etat français dans la Constitution depuis l’avènement de l’UE : Du vent, brassé par des moulins politiques bien ancrés dans leurs sièges, mais qui reste du vent.
Je préfère avoir des juges partiaux que dépendants du Gouvernement ; Avoir les deux, ça souligne simplement la fin de la Justice, avec un grand "J".
Bien à vous, de retour sous l’Ancien Régime. Montesquieu doit se retourner dans sa tombe.
Ce qui est présenté dans cet article, ce sont des nombres objectifs qui montrent des variations de taux de rejets importantes entre juges sur une question spécifique en droit administratif.
Nous ne prétendons pas pouvoir montrer qu’un juge en particulier a tort ou raison, ni qu’il y a un bon ou un mauvais taux.
Simplement, il est surprenant de trouver de telles variations que rien à notre connaissance nous semble justifier.
Ce que vous demandez, c’est la recherche des causes de ces variations et de cette possible partialité.
C’est en dehors de l’objet de cet article et hors de notre portée (lorsque l’on s’appuie sur les décisions elles-mêmes).